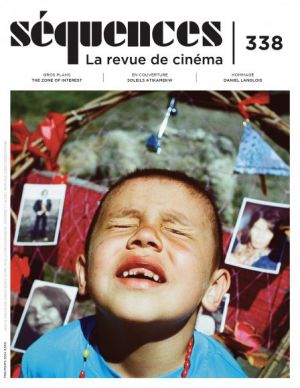Articles récents
Star Wars
4 mai 2021
Patrick Schupp
Critique parue dans le numéro 89 (juillet 1977) de Séquences

Il était une fois, il y a bien longtemps, et très très loin, dans une galaxie lointaine, une planète aride et désolée, Tattoine. C’est là qu’habitent le jeune Luke Skywalker, et ses parents adoptifs. Mais lorsque ceux-ci auront été tués lâchement par les représentants des Forces Galactiques, dirigées par l’odieux gouverneur Moff Tarkin, assisté du cruel et perfide Darth Vader, le sombre Seigneur du Sith, Luke se lancera à la poursuite des meurtriers, et au secours de la jolie princesse Leia, kidnappée par Vader et Tarkin. En effet, celle-ci détient le secret de l’Étoile Noire, l’arme ultime qui permettra aux peuples opprimés par le Gouverneur de reconquérir la liberté.
Ainsi donc, Luke a entre-temps visité plusieurs planètes et trouvé aide et conseils en Ben Kenobi, le dernier des Chevaliers Jedi, les gardiens de la Paix d’autrefois, et amitié dans la personne de Han Solo, sympathique et indépendant propriétaire d’un croiseur interstellaire, le Millenium Falcon…
Deux robots (See-Threepio : C-3PO et Artoo-Detoo : R2-D2) et Chewbacca (un Wookie, c’est-à-dire une sorte d’anthropoïde aux yeux bleus et à l’orgueil froussard) se joignent aux trois rebelles et ainsi commence et continue la plus merveilleuse aventure de joie, de détente et de délassement, à travers le temps, l’espace et les étoiles…
Star Wars est le dernier-né de George Lucas, dont le remarquable American Graffiti (sorti en 1973) avait permis d’espérer mieux encore. C’est ce qui arrive avec Star Wars, dont le projet était déjà dans l’air avant même American Graffiti. En 1971, Lucas voulait déjà filmer un space opera, c’est-à-dire un genre jusqu’ici très important en littérature, mais quasi inexistant sur film. 2001: A Space Odyssey y touchait un peu, mais le message philosophique l’emportait finalement. En fait, ce que voulait Lucas, c’était un film de divertissement, sans complications intellectuelles; il avait eu l’envie de faire un film sur Guy l’Éclair (Flash Gordon), le célèbre héros des bandes dessinées d’avant-guerre. En cherchant donc, Lucas découvrit qu’Alex Raymond, le créateur de Flash Gordon, en avait trouvé l’idée dans les œuvres d’Edgar Rice Burroughs (l’auteur mondialement connu de Tarzan), dans sa série des John Carter sur Mars. Cette série à son tour avait été inspirée par une fantaisie galactique, Gulliver sur Mars, écrite par Edwin Arnold et parue en 1905.
Alors de même que pour ses deux films précédents. THX 1138 et American Graffiti, Lucas décida d’écrire son propre scénario, de 1971 à 1976 : lisant, absorbant, remettant vingt fois sur le métier son propre ouvrage, jusqu’à ce que le scénario final soit prêt, les comédiens engagés, et les plans de production prêts à fonctionner. Le scénario rappelle l’oeuvre de Merritt, fait penser au meilleur Katherine Moore (celle de Shamblrau), a des réminiscences de Frederick Pohl, incorpore Guy l’Éclair, Prince Vaillant, le Magicien d’Oz et fait aussi penser aux films de cape et d’épée des années 30; et le miracle, c’est que tout cela fait bon ménage, que le scénario, loin d’être un ramassis d’idées et de situations, est plutôt une somme, une synthèse du genre, et ne laisse rien à désirer sur le plan de la construction. Ajoutez à cela des effets spéciaux et une technique absolument fantastique — parfois plus réussie que 2001: A Space Odyssey qui servait jusqu’ici de mesure et de référence — une interprétation parfaitement dans la note (les bons sont en blanc, les méchants en noir, comme il se doit, les sentiments sont simples, et basés sur la liberté, la noblesse, l’amour récompensé, la lutte du bien et du mal, avec victoire du premier, bien sûr, au terme d’une bataille intergalactique épique), et vous aurez la recette infaillible d’un film qui est en train de battre les records d’entrée partout où il passe. Jeunes de 7 à 77 ans s’y retrouvent, et applaudissent à tout rompre à la fin du film, lorsque le méchant Darth Vader est battu par Luke (mais il réussit quand même à s’échapper, pour que Lucas lui prépare une revanche dans une suite qu’il est déjà en train de préparer), prouvant par là sans réserve que ce genre de cinéma a non seulement une place indispensable et réelle, mais que les gens en ont assez de la fesse et de la violence, et que maintenant, c’est ce genre de films qu’ils recherchent. À New York, où j’ai vu le film, c’était du délire à la fin de la représentation, tout le monde debout applaudissant à tout rompre comme à Guignol, et unanimement.
Presque tout le matériel, les techniciens et les comédiens viennent d’Angleterre. Pour le rôle de Artoo-Detoo, le directeur de production John Barry a réussi à dénicher le plus petit homme d’Angleterre : Kenny Baker, 3 pieds 8 pouces… Autour de lui fut construite une espèce de machine qui ressemble à un aspirateur de type professionnel, avec des jeux de lumière, et des « jambes » qu’il pouvait manoeuvrer de l’intérieur. See- Treepio lui, construit de fibre de verre, de plastique, d’acier et d’aluminium semblait facile à manier à Anthony Daniels, la « mécanique humaine » du robot. Mais Lucas avait compté sans l’ardent soleil de Tunisie (pays où furent tournées les scènes de Tattoine) qui menaça de cuire le pauvre Daniels au four, à l’intérieur de sa brillante carapace.
Et lorsque Han Solo et Luke se rencontrent dans un bar louche de Tattoine, irrésistiblement, les descriptions de Catherine Moore remontent à l’esprit. Dans La Poussière des dieux, il y a une extraordinaire taverne martienne qui a été reconstituée dans le film avec un soin jaloux par Lucas; ou si ce n’est pas celle-là, c’en est une autre exactement semblable.
Car finalement ce qui compte, au-delà de l’anecdote, de l’aventure pour l’aventure, c’est cette oeuvre d’art, impalpable, ténue, omniprésente, issue de ce qu’on appelle le talent. Le poète est doublé d’un technicien, et le film, ce n’est pas une galerie de monstres plus vrais que nature, ou une série d’aventures interplanétaires : ce sont les effets dits spéciaux, dont certains ont été réalisés pour la première fois. Artoo-Detoo, par exemple, fait passer le message de la princesse au centre de la pièce, par l’intermédiaire de l’holographie, maladroitement utilisée dans Logan’s Run, l’an dernier. Lucas a aussi travaillé beaucoup plus rapidement que Kubrick, dont le 2001: A Space Odyssey, comme je le disais plus haut, servait jusqu’ici de référence. John Dykstra, expert dans son domaine, est responsable des extraordinaires photos et plans des batailles, des vaisseaux interstellaires, grâce à l’utilisation d’un calculateur électronique qui enregistrait et conservait dans un classeur tous les plans, ce qui permettait à Lucas de rajouter des éléments, au fur et à mesure de son inspiration ou du scénario. Les maquettes sont également très impressionnantes (à tel point que Lucas se les est fait voler, et qu’elles sont réapparues sur le marché noir à un prix exorbitant, et immédiatement raflées à prix d’or par des aficionados ou des collectionneurs).
Tel quel, Star Wars est un film exceptionnel, passionnant, merveilleux, admirablement fait, et aussi la preuve que le cinéma n’est pas mort, ni le talent des metteurs en scène. Lucas fait d’ailleurs partie du « groupe des 4 » (Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, et Steven Spielberg sont les trois autres), et il est incontestable que cette jeune génération domine, et de loin, l’industrie cinématographique d’aujourd’hui aux États-Unis. Nous pouvons attendre la suite de pied ferme.
Pour retrouver les décors réels du commissaire Maigret
29 avril 2021
Yves Laberge
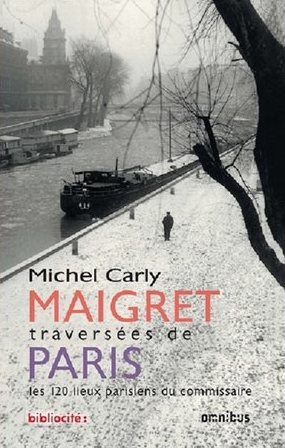
Grand spécialiste de Simenon — auquel il a consacré cinq livres (!) —, Michel Carly nous invite à une visite particulière de Paris en indiquant des dizaines de lieux réels où se déroulaient les enquêtes du commissaire Maigret, adaptées des centaines de fois au petit et au grand écran. Romancier prolifique, Georges Simenon (1903-1989) s’inspirait de son environnement immédiat — le Paris de sa jeunesse — pour y ancrer ses récits policiers. Méticuleusement, Michel Carly effectue le pont entre le réel et l’imaginaire dans l’univers de Simenon en signalant les lieux de tournage, ou encore tel restaurant parisien, tel hôtel chic — ou tel autre plus sordide — ayant servi de toile de fond pour un roman ou un long métrage comme Maigret tend un piège (1958), de Jean Delannoy (p. 37), dans lequel le bureau du célèbre commissaire avait été reconstitué d’après les descriptions très détaillées écrites par Simenon.
Certains lieux mythiques, mille fois filmés, sont ici décrits, comme le magnifique restaurant La Coupole, au 102, boulevard du Montparnasse (pp. 66-69). Au moins trois versions de La tête d’un homme s’y déroulent, dont celle tournée avec l’acteur Jean Richard, qui personnifia Maigret des dizaines de fois. Michel Carly suggère de s’y rendre pour y lire quelques pages de l’œuvre et s’imprégner de cet endroit légendaire, naguère fréquenté par Simenon et tant d’autres écrivains, cinéastes et artistes de renom. Et en outre, on y dîne délicieusement.
Ailleurs dans ces Traversées de Paris, on signale le luxueux Hôtel Claridge, près des Champs Élysées, où furent tournées plusieurs séquences du long métrage Stavisky (1974) d’Alain Resnais (p. 110), et dont l’affaire avait beaucoup intéressé Simenon à ses débuts (sans qu’il ne lui consacrât un roman), durant les années 1930. À propos du célèbre Claridge, Michel Carly commentera : « Simenon y descendra fréquemment » (p. 109). Tout comme le couple Jean Gabin et Marlène Dietrich, qui y résidait en 1945 (p. 110). Les photographies anciennes ont été judicieusement choisies : on croirait reconnaître le jeune Simenon vêtu d’un imperméable devant la façade du Modern Hôtel, sis dans une rue sombre (p. 97). On évoque d’ailleurs certains lieux parisiens où Simenon a logé (p. 85). Plus loin, Michel Carly nous aide à retrouver le restaurant chic fréquenté entre autres par Simenon, le commissaire Maigret (et son épouse), mais aussi par Jean Gabin et Brigitte Bardot dans En cas de malheur, réalisé par Claude Autant-Lara en 1958 (et adapté du roman de Simenon); autrefois nommé Chez Manière, mais rebaptisé Le Cépage montmartrois (p. 127). Il fallait le savoir pour pouvoir retrouver ce lieu célébrissime que l’on aurait pu croire disparu, mais plutôt renommé.
Anecdotique? Plutôt une contribution utile, bien documentée et précise pour mieux comprendre cette mythologie populaire liée au Paris d’après-guerre; on peut visualiser, imaginer et parfois reconnaître. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de distance et après plusieurs décennies, à quoi peuvent servir ces « 120 lieux parisiens du commissaire »? Les raisons seront multiples. Pour le lecteur québécois, ce livre pourrait un jour lui servir de guide de promenades dans les rues parisiennes afin d’y retrouver l’esprit de lieux plus ou moins célèbres, pour saisir l’imaginaire des dizaines d’œuvres de Simenon ancrées dans le Paris du milieu du XXe siècle. Ou encore pour « entrer dans le film » et se plonger dans le rêve. Et puis découvrir l’envers du décor. Pour rendre possible un pèlerinage culturel et cinématographique. Pour qu’on nous signale au passage l’Allée des Brouillards : le lieu de naissance du grand ami de Simenon, Jean Renoir, qui adaptera l’un des premiers Maigret au cinéma, La nuit du carrefour, en 1932 (p. 129).
Ce Maigret : traversées de Paris intéressera les amoureux du Paris d’autrefois, qui évite les endroits touristiques et clinquants. Quelques cartes, un index et plus de 180 photographies en noir et blanc agrémentent ce livre soigné et précis (1).
Note
(1) En guise de complément, on lira, sur les librairies de fond et les lieux littéraires parisiens, l’excellent livre de François Busnel, Mon Paris littéraire, Paris, Flammarion, 2016.
–
Michel Carly
Maigret : traversées de Paris : les 120 lieux parisiens du commissaire Paris, Éditions Omnibus et Bibliocité
2019 [1e édition en 2003], 189 p.
Penser le cinéma, faire le cinéma
16 avril 2021
Yves Laberge

Du format d’un livre souple, la Revue Cités offre des numéros thématiques, selon la grande tradition des revues d’idées en France; pensons à la Revue des Deux mondes ou à Esprit, ou encore Le Débat. Une fois n’est pas coutume, le dossier de son N° 77 est consacré au cinéma, et ses neuf articles situeront le 7e art selon des perspectives philosophiques, pratiques ou proches des sciences sociales. L’image de couverture montre l’équipe de François Truffaut lors du tournage de son adaptation de Fahrenheit 451 (1966).
L’article d’ouverture d’Avishag Zafrani se base sur le diagnostic du philosophe et théoricien Théodor Adorno (à propos de la production industrielle des biens culturels) pour montrer le caractère pernicieux du film lorsque celui-ci devient uniquement l’instrument d’une culture de masse axée sur une idéologie conformiste, la rentabilité, le nivellement par le bas : « Nouvel opium, il produit une morale compensatoire qui annihilerait toute résistance potentielle » (p. 11). Cette interrogation empruntée à la théorie critique reviendra dans certains textes subséquents.
Dans un entretien centré sur les « Nouveaux enjeux économiques du cinéma », le producteur Éric Altmayer explique les tendances actuelles quant au financement des œuvres, souvent à la merci des bailleurs de fonds qui reproduisent une conception étroite de ce que devrait être « un bon film ». Altmayer le déplore et souligne un paradoxe apparent : « On se targue en France d’avoir beaucoup de producteurs indépendants, mais la plupart de ces producteurs indépendants sont en réalité très dépendants, ils dépendent justement du bon vouloir des chaînes de télévision, ou de subventions et ils sont en permanence en cavalerie, espérant que le prochain film pourra financer les frais de structure du précédent investissement » (p. 21). Dans un autre entretien, le cinéaste et théoricien Jean-Louis Comolli expose sa conception du documentaire, car « le cinéma apprend à regarder le monde » (p. 40); et « la pratique documentaire est une pratique éducative » (p. 40).
Ce dossier éclaté comprenant des textes plus hermétiques et totalisant près de cent pages se conclut sur sa contribution la plus inspirante, à partir des remarques éclairées de Mathieu Rasoli (« Éduquer par/avec le cinéma? ») qui base d’abord sa réflexion sur Émile Durkheim (p. 83) pour ensuite revaloriser des approches un peu oubliées comme l’éducation aux médias, l’éducation artistique et — ultimement — l’éducation au cinéma (p. 93). Cet impératif d’initier les élèves à la portée de l’image animée et pouvant être largement diffusée devient d’autant plus nécessaire que la nouvelle génération peut — potentiellement — devenir, le plus facilement du monde, un cinéaste ou un « fabriquant d’images » (pour reprendre l’expression judicieuse de Mathieu Rasoli) en mettant en ligne un film personnel ou un autoportrait filmé, grâce à des supports comme YouTube et autres réseaux sociaux (p. 94). En ce sens, une éducation à l’acte même de filmer — et à ses implications, ses conséquences potentielles — devient désormais indispensable, surtout pour les jeunes élèves. Sur ces questions inépuisables et actuelles, Mathieu Rasoli parvient à produire un article invitant, clair, instructif, inspirant et bien documenté.
Globalement, ce dossier de la Revue Cités permettra au lecteur québécois de situer — fragmentairement — quelques-uns des horizons de référence dans la réflexion savante sur le cinéma dans la France actuelle. Les approches sont variées : si les praticiens (Éric Altmayer ; Jean-Louis Comolli) rappellent la prépondérance de l’économique supplantant désormais la dimension créatrice ou artistique — et en cela, beaucoup de pays en sont réduits à imiter le modèle ultra-commercial hollywoodien —, les théoriciens et les cinéastes de la marge (comme Raoul Peck, ici interviewé dans l’avant-dernier article) tentent pour leur part de reconcevoir ou de critiquer le monde tel qu’il nous apparaît dans le mainstream, en prônant à travers des circuits alternatifs « un cinéma autrement », pour emprunter la belle formule de Dominique Noguez. En tant que tel, ce dossier N° 77 ne comprend pas d’illustrations; mais certains des articles hors-dossier contiennent des photographies anciennes. Comme dans toute revue de ce calibre, les dernières pages proposent des notes de lectures et des recensions de livres, entre autres autour de la biographie récente consacrée au philosophe Jürgen Habermas (pp. 185-196). Au Québec, la Revue Cités ne se trouve pas chez les marchands de journaux, mais plutôt en librairie, sur commande spéciale ou par abonnement. C’est le type de revue que l’on conserve, même après l’avoir lue en entier.
–
(Collectif)
Penser le cinéma, faire le cinéma. Revue Cités, N° 77
Presses universitaires de France, Paris
2019, 199 p.