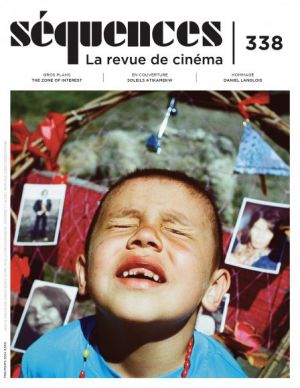Articles récents
No 327 – Le secret des dieux
7 juillet 2021

Dans les dernières semaines, j’ai entendu mon lot d’histoires qu’on m’a sommé de ne pas ébruiter. Parfois des ragots, dans certains cas des rumeurs sans grande importance, souvent des témoignages consternants de la bouche de principaux témoins ou concernés. Assez pour se lancer gaiement dans l’écriture d’un petit Livre noir du cinéma québécois. Vous me direz que c’est comme ça dans tous les milieux. Il y a l’histoire officielle, celle des communiqués de presse et des réseaux sociaux, puis celle officieuse, faite de teintes grises et de détails croustillants, qui circule de façon aléatoire, selon le principe du téléphone arabe, au point qu’il peut être tout autant risqué de s’y fier lorsqu’elle parvient à ses oreilles. L’être humain adore colporter des histoires et être le dépositaire de secrets bien gardés ! Ne mentez pas, vous aussi avez déjà ressenti ce petit frisson lorsque sont prononcés ces mots en apparence naïfs : « Garde ça pour toi, mais j’ai entendu dire que… »
Aucun scoop digne d’Échos vedettes ne vous sera ici dévoilé. Ce n’est ni le lieu ni l’endroit. En toute franchise, la plupart du temps je préférerais ne pas être mis au courant de ce qui se trame dans les coulisses de l’industrie et n’avoir qu’à me concentrer sur le contenu des films à couvrir, à décortiquer et à mettre en lumière. Les critiques ont-ils à se mêler de ce genre d’intrigues ? Ce qui revient à poser cette sempiternelle question : à quel point peuvent-ils fricoter en toute impunité avec cinéastes, programmateurs et comédiens ? Pauline Kael, c’est bien connu, soupait volontiers avec les cinéastes qu’elle appréciait et défendait. D’un autre côté et plus près d’ici, Robert Lévesque soutient que, dans ce métier ingrat, il faut être « l’allié de personne ». Où trancher ? Et il est particulièrement difficile, vu la taille du Québec, de ne pas moindrement « se fréquenter ». D’autant plus que le critique doit plus que jamais diversifier son porte-folio. Ceux qui gagnent ainsi leur vie ne sont pas légion; on peut sûrement les compter sur les doigts d’une main et ils travaillent dans deux ou trois médias de masse. Autrement, il faut s’organiser, en devenant programmateurs, enseignants, directeurs de festival, scénaristes, éditeurs, animateurs de cinéclubs. Le critique est partout et, qu’il le veuille ou non, finit toujours par tout savoir.
Alors, il fait quoi avec ce qu’il sait, le critique ? Surtout lorsqu’il détient des informations qu’il considère comme d’intérêt public ? Des informations qui touchent des organismes et festivals subventionnés ? Savoir sans agir reviendrait-il à cautionner des largesses, des manquements à l’éthique ? Je connais plusieurs critiques qui préfèrent garder profil bas et se concentrer sur les films, faisant fi de leurs tenants et aboutissants. Et ils ne sont pas à blâmer, leur travail étant déjà assez compliqué comme ça ! Mais force est d’admettre que nous sommes parfois bien envoûtés devant les images qui dansent sur nos écrans, au point d’oublier qu’il n’y pas que les films qui sont tissés d’illusions.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
Séquences au Festival du film de Munich 2021
3 juillet 2021
On associe beaucoup plus la ville de Munich à la bière qu’au cinéma. C’est pourtant la ville-hôtesse du second plus grand festival de films en Allemagne et le premier en Europe à ré-accueillir des visiteurs en salle. Au cours de ses 38 années d’existence, le Filmfest München a été le moteur de propulsion des plus grands noms du cinéma germanique. De Rainer Werner Fassbinder à Wim Wenders en passant par Werner Herzog, tous les cinéastes ouest-allemands des années 70-90 étaient basés à Munich. Appelés ici comme juré pour la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI), nous découvrons une métropole cosmopolite, infiniment plus branchée et stylée que les sempiternelles images d’Oktoberfest véhiculées à chaque automne. Suite aux premières projections, force est d’admettre que la nouvelle génération de réalisateurs allemands ouvre des portes, offre des perspectives originales et prend des risques. Pour les dix prochains prochains jours, nous vous offrons une revue exclusive (pandémie oblige, Séquences est le seul média international à Munich) du nouveau cinéma allemand.
Jour 1
Heures sombres et peaux ombrées

Le nombre exact de films sur l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale doit avoisiner le milliard. Oui, bon, c’est exagéré, mais vu de l’Allemagne c’est le sentiment qu’on en a! Offrir une nouvelle perspective sur cette période, particulièrement sur les Juifs-Allemands, représente donc un immense défi. Défi accepté par Benjamin Martins avec Schattenstunde (L’heure de l’ombre), qui tire des écrits de Jochen Klepper une oeuvre troublante sur une famille qui décide, à la veille de sa déportation dans les camps, de se suicider. En 1942, Klopper est un écrivain et poète chrétien reconnu et respecté au sein du IIIième Reich. Marié à Johanna, une Juive, il est le père adoptif de sa fille Renate. Toutes les deux ont demandé des visas pour la Suède. Adolf Eichmann, père de la Solution finale, refuse à Klepper les visas et lui propose, fort courtoisement, de divorcer. Sachant parfaitement ce qu’il adviendra de sa famille dans ce cas, Klepper revient chez lui et met en place leur Plan B, l’échappatoire ultime déjà préparée de longue date avec les siens, celle du suicide collectif. S’en suit une série de tête-à-têtes entre Klepper et son fidèle voisin Hans, dévasté par cette décision, mais surtout avec sa conscience personnelle de chrétien, pour lequel le suicide est interdit. Cette conscience prend la forme d’un démon goudronné qui s’installe à table et entame une discussion digne de Faust.
Le jeune réalisateur prend beaucoup de risques avec ce film, non seulement à cause de l’intensité du sujet, mais aussi parce qu’il mélange les genres, intégrant des échanges et des effets plus courants au théâtre. Marionnettes, murs rétrécissants, dialogues de théâtre; il mélange les formes, tissant une toile cinémato-théâtrale qui ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais qui convient au drame qui se déroule sous nos yeux, en lui donnant un tour poétique. Le dialogue est basé sur les notes de Jochen Klepper, sur les dernières heures de son existence, sauvegardées par Hans et publiées de façon posthume par sa sœur après la guerre.
À l’heure du profit à tout prix et de la comédie, voilà un sujet sérieux, traité avec pudeur et poésie, et qui parle de vie, de mort et de cinéma. Ce n’est pas si courant.
Precious Ivie

Qu’un film allemand discute de racisme, on s’y attend. Que les nouveaux cinéastes allemands en parlent… Normal! Ce qui est différent dans le film de Sarah Blasskiewitz, c’est que son sujet est une discussion sur la multiplicité des formes du racisme vis-à-vis des noires allemandes en ex-Allemagne de l’Est. Il y a le racisme laid, qui éructe et qui crache, le racisme institutionnalisé de la police et des fonctionnaires bien-pensants, mais aussi le racisme innocent, le bien-intentionné, le racisme ébahi de ceux qui le commettent sans jamais s’y être attardés.
Ivie, Afro-Allemande baptisée Choco par sa bande de copains, vit avec sa meilleure amie Anne à Leipzig. Elle travaille temporairement dans le solarium de son ex-petit ami Ingo, alors qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi permanent en tant qu’enseignante. Soudain, sa demi-sœur Naomi, berlinoise branchée, frappe à sa porte et la confronte à la mort de leur père et à ses funérailles prochaines au Sénégal. Aucune des deux sœurs ne se connaissait, ni ne connaissait leur père, et elles se débattent maintenant avec l’idée d’apprendre à connaître le côté de sa famille. À mesure que les sœurs de ces deux grandes villes très différentes se rapprochent, Ivie remet de plus en plus en question non seulement son surnom, mais aussi sa culture et l’image qu’elle a d’elle-même. Cette remise en question va entraîner celle de tout son entourage.
Sarah Blasskiewitz, qui tourne ici son premier film, démontre une rare maîtrise du langage cinématographique, tant dans la vérité de ses images que dans sa direction d’acteur. Sous-tendu par un scénario riche et complexe, où aucun des personnages n’est mis de côté, et par le brillant jeu des actrices Haley Louise Jones et Lorna Ishema, Precious Ivie crie le vrai sans gueuler, poétise sans versifier, interroge sans brutaliser. Un beau morceau de cinéma, fin et brûlant, tissé d’or liquide.
ANNE-CHRISTINE LORANGER
Souterrain
4 juin 2021
On pioche pic pac pic pac dans la mine, le jour entier
Maxime Labrecque

Avec Souterrain, Sophie Dupuis confirme qu’elle fait partie d’une vague de cinéastes qui incarne un renouveau cinématographique. Avec quatre courts métrages et un premier long remarqué, Chien de garde, la réalisatrice possède déjà une feuille de route enviable. Apportant fraîcheur et vision au cinéma québécois en le sortant d’une certaine morosité et d’un repli identitaire, son plus récent film n’est pas pour autant un hymne à la candeur. Pour son second long métrage, Sophie Dupuis délaisse le Verdun de Chien de garde pour explorer l’arrière-pays, cette Abitibi-Témiscamingue que bien des Québécois n’ont encore jamais explorée, lui préférant Fort Lauderdale. C’est donc tout un pan de notre territoire, tout un volet de cet exotisme québécois qui demeure insoupçonné. Avec habileté, la réalisatrice parvient dès les premières images à immerger les spectateurs dans un monde peu connu et fascinant ; un monde qui est pourtant le nôtre. Le film devait ouvrir la 49e édition du Festival du nouveau cinéma, mais en raison des grands vents et de la pluie, la soirée au ciné-parc à l’aéroport Trudeau a dû être annulée le jour même, après moult péripéties en raison de la 2e vague de COVID-19 qui entraîne une fois de plus dans son sillage le monde des arts.
Qu’à cela ne tienne ! Le film, de par sa fougue, trouvera bien son chemin autrement. Il s’agit d’une rare incursion dans l’univers minier québécois, ce monde souterrain et silencieux où prévaut un code de vie très strict. L’imaginaire minier, dans la littérature française, demeure quelque peu prisonnier du legs de Germinal, roman naturaliste d’Émile Zola. L’adaptation qu’en a faite Claude Berri en 1993 – et, surtout, l’annonce par France Télévisions en octobre 2020 d’une série basée sur le roman – témoigne d’un intérêt renouvelé pour cet univers. Avec Souterrain, la réalisatrice fait le choix conscient de dépeindre de la manière la plus réaliste possible cet univers au sein duquel elle a grandi. Bien que son père soit mineur et sa mère infirmière dans les mines, Sophie Dupuis a tout de même dû apprivoiser cet univers. Plus le film avance, plus le climat anxiogène contamine le spectateur, comme cela était également le cas avec Chien de garde. La construction du suspense est ici particulièrement réussie. Alors qu’on serait en droit de s’attendre à un coup de grisou, la réalisatrice met savamment en place des éléments annonçant une catastrophe personnelle tout autre. Or, par la force des choses, cette catastrophe demeure proprement collective, car dans une mine, la règle du chacun pour soi n’a pas lieu d’être. En effet, si le mineur n’est pas pleinement en contrôle de son état d’esprit, le moindre égarement peut devenir périlleux pour ses collègues. Il s’agit d’une première leçon que les profanes retiendront de ce film, où l’éthique du travailleur est exposée de manière convaincante.
Conseillée par son directeur de la photographie, Sophie Dupuis a choisi de ne pas se laisser impressionner par le décor grandiose et hautement cinématographique que représente la mine. Pourtant, il s’agirait ici d’un choix artistique évident tant cet univers frappe l’imaginaire. Mais la réalisatrice ne souhaite pas raconter l’histoire d’un lieu ; ce sont, vraisemblablement, ceux qui l’habitent qui l’intéressent. Si dès l’ouverture, grâce à un impressionnant plan d’ensemble, cette mine sur une île au milieu d’un lac est survolée, jamais on n’abuse des drones ou de pirouettes stylistiques pour exulter le caractère exotique du Nord. On ne sombre pas dans une enfilade de plans d’ensemble esthétisants ; la mine, lorsqu’elle est filmée, n’est que trame de fond pour les personnages. Car pour la réalisatrice, c’est sur eux que toute l’attention doit être dirigée. Sophie Dupuis, après tout, aime profondément ses comédiens et elle parvient à tracer les contours des personnages qu’ils campent de manière juste et sensible. Chaque regard, chaque grimace, chaque froncement de sourcil doit donc être capté.
En choisissant ses comédiens et comédiennes avec une grande intuition et au bout d’un long processus d’audition, la réalisatrice recherche une justesse et une certaine vulnérabilité. Elle renoue avec Théodore Pellerin qui, une fois de plus, démontre qu’il est sans conteste l’un des comédiens les plus talentueux de sa génération. En interprétant un jeune aphasique, il évite les écueils que ce type de personnage pourrait rencontrer. Aux côtés de Joakim Robillard – heureuse découverte dans le rôle de Maxim –, il remet en question la notion d’amitié véritable lorsque celle-ci est empreinte de culpabilité. Mais au-delà de ces deux personnages, Souterrain pourrait se classer sous la bannière du film de groupe, car c’est véritablement une communauté qui y est dépeinte. Une communauté masculine, d’abord, même si les femmes y ont leur place, qu’on pense à Catherine Trudeau ou à Chantal Fontaine. Fidèle à ses préoccupations habituelles, la réalisatrice aborde, avec des personnages forts campés par des acteurs de talent – notamment James Hyndman qui se révèle sous un nouveau jour –, une fraternité soudée et codifiée qui peut, parfois, sombrer dans une forme de masculinité toxique.
Ne jamais montrer sa part de vulnérabilité – en gardant une façade artificielle faite de clichés et d’assertions erronées sur ce qu’un « vrai gars » devrait être – demeure un réflexe encore bien ancré chez tant d’hommes. Pourtant, cette figure masculine idéalisée par plusieurs n’est qu’un leurre. L’homme qui professe ces traits à outrance est, au fond, prisonnier d’une image désuète et, ultimement, dangereuse. Il s’agit d’une image qui prône le repli sur soi plutôt que le dialogue, générant son lot de comportements erratiques et malsains. Même si la société a fait un certain chemin en dénonçant ces comportements, force est d’admettre que cette masculinité toxique résonne encore chez bien des hommes, ce que Sophie Dupuis ose aborder en évacuant les clichés. À travers le personnage de Max, qui professe sa capacité à faire mille enfants à sa blonde et qui atteste sa valeur à travers ses possessions matérielles, un archétype est créé. Pour ce buck dont la virilité ne doit jamais être contestée, la façade robuste qu’il crée de lui-même est pourtant friable. Ainsi, au-delà de cette communauté d’hommes que l’on pourrait croire monolithique, on parvient à découvrir un microcosme fascinant, un univers peuplé par des êtres emplis de contradictions.