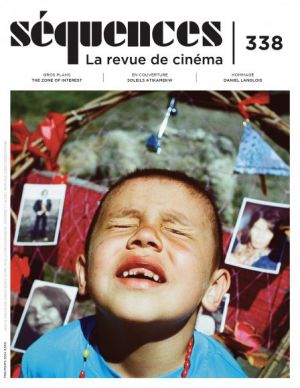En ligne
Une femme, ma mère
11 juillet 2020
L’album de famille impossible de Claude Demers
Catherine Bergeron

La photographie a cette capacité étonnante et poignante de donner à voir un certain quelque chose qui a été, disait fameusement Roland Barthes. Elle porte en elle cette qualité lui permettant d’arrêter un instant qui sera ensuite communiqué sous une autre forme. Cette photographie, que l’on pourrait nommer « amateur » et « de famille », trouve sa magie dans le fait que quelque chose a simplement existé devant la caméra. La force de la photo de famille serait donc exactement cela : la famille. Elle arrive à mettre en images cette famille que l’on reconnaît comme faisant partie de nous, cette famille qui point de manière à nous dire un peu plus qui nous sommes. Mais comment reconstruire et partager notre histoire lorsqu’on possède aucune image?
Construit comme une suite de tableaux vivants, de photographies en mouvement, le dernier long-métrage de Claude Demers, Une femme, ma mère (2019) (Grand prix de la compétition nationale longs-métrages aux RIDM), se présente comme le magnifique, touchant et gigantesque album de famille de celui qui, douloureusement, se trouve en quête de sa propre histoire. Poursuivant les préoccupations classiques du cinéaste (D’où je viens, 2014), tournant autour des thèmes de l’adoption, la mémoire, la filiation, l’héritage et la réconciliation, le film propose une incursion tout en douceur et en vulnérabilité dans l’enquête menée par le cinéaste pour retrouver sa mère biologique, l’ayant abandonné à la naissance.
Évoluant dans le Québec des années 1950, alors que la Grande Noirceur, avec son régime conservateur et clérical, tire à sa fin devant la mouvance nécessaire et incontrôlable d’un peuple cherchant la modernité et la mise à niveau, la mère de Demers est présentée comme cette femme moderne, tristement victime de cet entre-deux. Ne voulant jamais avoir d’enfant, elle a porté ce bébé dans la honte et l’amertume, criblant son ventre de coups, s’exilant lors de sa grossesse et accouchant, seule et anonyme, dans une crèche de Montréal. Claude Demers est ainsi né, raconte-il, d’une mère qui a tout fait pour brouiller les pistes de sa propre existence, une mère qui, l’abandonnant sans nom, le fera nommer « Jarry », comme tous les autres bébés étant nés dans la même semaine.
Ces histoires, nous les apprendrons d’une seule manière : elles seront racontées par la voix empathique et sereine du cinéaste. Par la parole, il retracera son enquête, accumulant les rencontres, les lectures de registres et les embauches de détectives pour arriver jusqu’aux retrouvailles, qui seront loin du conte de fée. Comme une longue lettre adressée à sa mère, il partagera ses états d’âme, ses doutes et questionnements, en portant toujours en lui un respect et un amour inconditionnels pour celle qui, cherchant le bonheur, n’a pu faire autrement.
Sans aucune image de cette quête ou de cette rencontre, le film utilisera alors le motif même de la vie de Demers pour lier la voix à l’image : l’adoption. Car c’est en adoptant une série d’images qui ne lui appartiennent pas, une série de portraits de femmes, réunis par la beauté de leur noir et blanc, et leur référence commune à la femme du milieu du siècle dernier, que le cinéaste traduira en images son périple. Film de montage, Une femme, ma mèreoscille ainsi visuellement entre des images d’archives documentaire, des images tirées d’autres œuvres cinématographiques et des images reconstituées par le cinéaste et son équipe. Toujours différentes, les femmes apparaissent pourtant à l’écran sous l’image d’une femme : la femme moderne, belle, séduisante et distinguée; la femme vivant dans les clairs-obscurs, celle tant aimée par le cinéma et les Grands qu’ont été Truffaut, Bergman, Resnais, Marker, Brault ou Groulx. Par son adoption des images, Demers adopte donc aussi la femme d’une époque, une époque révolue pendant laquelle sa mère a vécu et a grandi. Anonymes, fictives ou véritables, peu importe : ces femmes existent toutes comme l’image de celle que sa mère aurait pu être.
Évoluant dans le même espace-temps qu’Une femme, ma mère, Roland Barthes disait inoubliablement dans La chambre claire qu’il possédait cette image parfaite de sa mère chérie, mais que, impossible à partager pour que tous ressentent la même chose, il ne la partagerait jamais. Comme une réponse à Barthes, l’œuvre de Demers arrive comme la création même de cette image qui, pour le cinéaste, reste inatteignable. Chaque femme devient une fabulation permettant à Demers de s’écrire. Le cinéma arrive ainsi, ici, comme cet art offrant miraculeusement la chance de produire une image parfaite devant une histoire imparfaite, de créer, par la force du pardon, une mère belle et idéale devant la mère victime avalée par son temps. Hommage poignant aux mères et aux parents qui acceptent de prendre en mains leur rôle, ode sensible aux femmes qui ont le droit de vouloir autre chose, mais aussi testament de l’histoire d’un peuple et d’un moment qui ont connu une grande transformation, Une femme, ma mèrenous donne envie d’aimer, d’accepter et de pardonner comme peu de films arrivent aussi délicatement à le faire.
Les siffleurs
2 juillet 2020
Crimes et sifflements
Jérôme Michaud

Siffloter sa chanson préférée avec élégance n’est pas l’apanage de tous, mais il faut dire que l’on a rarement à le faire, les soirées endiablées de karaoké ne demandant pas d’entrer dans ce genre de technicalité, qui redonnerait pourtant un peu de lustre aux classiques souvent maltraités au petit matin. Cela dit, savoir siffler n’est pas du tout essentiel et personne ne perdra la vie s’il ne maîtrise l’art de former de petits bruits stridents émanant de sa bouche, à moins qu’il ne se trouve inexplicablement plongé dans l’univers des Siffleurs, dernier opus du déstabilisant cinéaste Corneliu Porumboiu. Partant de la pratique traditionnelle du langage sifflé silbo gomero pratiqué sur l’île de La Gomera dans l’archipel des Canaries, le cinéaste roumain s’inspire du film noir pour élaborer une intrigue alambiquée, mais finement ficelée dont les quelques apories sont rapidement pardonnées.
Dans une atmosphère où tout le monde est sous écoute, où chacun tente de protéger ses arrières et de dissimuler ses intentions, Cristi, impassible policier de la brigade des stupéfiants de Bucarest, s’est acoquiné avec la pègre, ne cessant d’informer son contact Zsolt de l’enquête menée contre lui, la faramineuse somme de 30 millions d’euros étant en jeu. Suite à l’arrestation de Zsolt, que Cristi a tenté en vain de prévenir, ce dernier se rend à l’île de La Gomera, rejoindre Gilda, femme fatale dont le charme l’a envouté, et le reste de la bande de mafieux afin d’apprendre avec eux à gazouiller le silbo gomero, et ce, dans le but d’utiliser ce moyen de communication secret pour faciliter l’évasion de Zsolt. L’art de siffloter devient ainsi l’élément pivot de la stratégie de libération, le moindre faux pas pouvant, théoriquement, mener à des conséquences tragiques.
On peut d’emblée reprocher à Porumboiu de se servir superficiellement du langage sifflé sur lequel il s’attarde pourtant longuement. Le silbo gomero, qui réduit le langage parlé à deux voyelles et quatre consonnes, aurait pu causer des quiproquos majeurs qui auraient servi de ressorts narratifs à l’intrigue, mais il n’en est rien. Cela dit, l’approche adoptée par le cinéaste produit une idéalisation d’un moyen de communication hautement faillible, mettant alors l’emphase sur la beauté sonore et musicale d’un chant intime qui a le grand avantage de permettre un échange hors du monde sans pour autant avoir à en sortir. Un peu comme si Porumboiu souhaitait pointer l’idée que ce dont on a aujourd’hui besoin est de retrouver une sphère privée, une façon d’être avec l’autre dans la confidentialité.
La grande force des Siffleurs est justement d’exposer la façon dont un individu peut se retrouver littéralement paralysé par une surveillance constante, réelle ou pressentie, technologique policière ou mafieuse. Caméras cachées ou téléphones sous écoute, si ce n’est que la police peut être à vos trousses, Porumboiu dresse le portrait d’un micro contrôle social d’une sournoiserie crasse apte à restreindre l’action au point de faire de quelqu’un le simple spectateur de sa propre vie, parfois même sans en avoir conscience. Si le film s’ouvre avec la mémorable pièce The Passenger d’Iggy Pop, c’est pour souligner que Cristi, protagoniste principal du film, n’aura qu’un rôle de passager, et ce, malgré la participation active qu’il tente d’avoir au sein de la rocambolesque histoire de gangsters dans laquelle il finira coincé entre ses collègues de la police et le groupe de mafieux. Il n’est pas anodin qu’il soit le dernier personnage formellement présenté à l’aide d’un intertitre, alors que les événements du film ont déjà diminué ses forces, formalisant son rôle d’observateur.
Le spectateur est aussi passagé d’un film dont les chamboulements incessants d’alliance deviendraient presque ridicules s’il n’était de la maîtrise de l’enchaînement dont Porumboiu fait preuve. Parsemée d’analepses explicatives, la première partie laisse ensuite place à une alternance entre les péripéties de Gilda et Cristi. À l’aide de ces deux modalités d’allers-retours qu’il maîtrise à merveille, Porumboiu met en place un rythme fluide capable de faire rougir tous les amateurs de karaoké dont le chant développe parfois une cadence erratique lorsque la nuit se prolonge.
It Must Be Heaven
11 juin 2020
Briser le silence
Daniel Racine

Avec 4 longs métrages en 23 ans, et une décennie complète entre Le temps qu’il reste et son plus récent It Must Be Heaven, on peut affirmer que le cinéaste palestinien Elia Suleiman aime prendre son temps. Il sait que ses œuvres, qui prennent souvent la forme de séries de tableaux humoristico-mélancoliques, parfois autobiographiques, sont très attendues. La preuve étant ses sélections en compétition officielle au Festival de Cannes, où en mai dernier il remportait une mention spéciale du jury en plus du prix FIPRESCI. Alors, pourquoi se presser, surtout qu’il construit habilement ses récits de méticuleuses observations de sa vie de tous les jours. Pour créer, il doit vivre et regarder son quotidien défiler devant lui, afin d’en extraire l’essence même de son travail.
Il y a aussi l’inextinguible conflit israélo-palestinien, braise constante qui demeure la trame de fond du réalisateur d’Intervention divine. Comment peut-il garder un regard neuf sur d’aussi vieux affrontements ? Dans It Must Be Heaven, Suleiman a justement eu la bonne idée de quitter son territoire après quelques scènes dans des lieux plus familiers, pour aller voir ailleurs, soit à Paris et à New York, deux mégapoles qu’il connait bien. C’est en portant en lui son État, et en montrant les travers des autres, qu’Elia Suleiman nous offre son film le plus mature, et peut-être le plus politique, tout en bonifiant son point de vue.
Si la majorité de ces séquences peuvent paraître d’une grande simplicité, c’est que Suleiman conserve uniquement ce qui est essentiel et universel pour mettre en scène sa vision de son « réel ». Comme cette série de tableaux avec un voisin, qu’il surprend dans son citronnier en train de voler quelques fruits. D’une fois à l’autre, celui qui « partage leur frontière commune » s’incrustera davantage sur son terrain. Il n’en faut pas plus pour y voir une illustration forte et amusante de cet envahisseur israélien. Et comme toujours, le personnage qu’incarne Elia Suleiman (ES est le nom donné à son protagoniste dans les descriptifs) communiquera uniquement par ses expressions faciales, de l’agacement à la désapprobation, de la stupéfaction à l’espoir retrouvé.
À ce sujet, les comparaisons sont fréquentes avec l’Étatsunien Buster Keaton et surtout le Français Jacques Tati. Pourtant, ce n’est pas tant dans leur personnage presque muet que dans la construction de leur mise en scène qu’il faudrait trouver d’importantes inspirations et ressemblances. C’est dans le volet parisien de son périple hors du Moyen-Orient que l’influence du créateur de Jour de fête est particulièrement frappante chez Suleiman. Que ce soit par le défilé des top-modèles dans une rue piétonnière de la capitale ou le ballet des policiers sur leur gyroroue, ces scènes font écho à la minutie et à la précision du Playtime de Tati. Les deux cinéastes partagent aussi une fascination pour les transports et les technologies, ces domaines étant souvent les bases de leurs meilleurs gags visuels. Mais chez Suleiman, il faut y ajouter l’aspect sécuritaire. L’omniprésence de l’armée ou de la police est frappante dans It Must Be Heaven, mais n’est pas surprenante quand on sait d’où il vient. Lui seul pouvait réussir à filmer une file de tanks face à la Banque de France et à fournir des armes à tous les passants de New York. Il ne craint pas l’exagération, sans toutefois noyer ses farces, pour que nous puissions à la fois rire et réfléchir.
Pour la première fois, Suleiman partage l’écran avec des personnalités connues, pour mieux illustrer l’isolement de son coin du monde. Ça débute à Paris, dans le bureau de Vincent Maraval, fondateur de la société de distribution et de ventes internationales de films Wild Bunch. Le cinéaste-acteur s’amuse en lui offrant un rôle sur mesure, Maraval tentant maladroitement d’expliquer à Suleiman qu’il refuse son prochain scénario de film parce qu’il n’est pas assez palestinien, « ça pourrait même se passer ici », lui dit-il, par cette belle mise en abyme. Il en sera de même à New York, où il rencontre la vedette mexicaine Gaël García Bernal, ce dernier qui patiente pour négocier un éventuel projet de film pour souligner le 500e anniversaire de la conquête mexicaine (tourné en anglais, bien entendu) avec la productrice québécoise Nancy Grant, celle qui est derrière les plus gros succès de Xavier Dolan. Même si García Bernal les présente, en précisant que Suleiman tourne une comédie sur la paix en Palestine, elle lance « c’est déjà drôle », lui serre la main en lui souhaitant la meilleure des chances, sans plus. L’intelligence et la pertinence de Suleiman sont là, dans ses deux refus qui en disent long sur le regard que nous portons collectivement sur le peuple palestinien. Toujours prêt à les reconnaître, comme ce chauffeur de taxi new-yorkais qui téléphone à sa femme pour lui dire qu’il est avec un Palestinien dans sa voiture, mais sans jamais être prêt à les aider concrètement.
C’est aussi dans ce taxi que le personnage de Suleiman parle pour la première fois. Dans Chronique d’une disparition en 1996, la genèse de sa filmographie, il était invité devant une salle pleine pour s’exprimer sur sa démarche artistique. Si nous étions convaincus de l’entendre, pourtant, dès qu’il s’approcha du micro, l’effet Larsen l’empêcha de prendre la parole. Il a conservé ce type de mise en situation tout au long de sa carrière, mais cette fois-ci, à la suite de la question du chauffeur « de quel pays viens-tu ? », ES, sans trop hésiter, répond « Nazareth », suivi de « je suis Palestinien ». Cela est très surprenant pour tous ceux et celles qui connaissent ses longs métrages presque par cœur. Elia Suleiman vient de prononcer quelques syllabes. L’importance de ses choix de mots est sans équivoque. Ce paradis sur lequel il semble s’interroger tout au long de ce voyage cinématographique, c’est son identité qu’il porte comme son ultime salut. Il brise enfin son silence pour affirmer haut et fort ce qui le définit, ce qui l’habite, ce qui fait de lui un cinéaste essentiel à notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. It Must Be Heaven est un magnifique cri du cœur, tout en douceur et en subtilité, d’un personnage qui boit pour se souvenir et qui garde espoir en voyant les jeunes palestiniens danser, comme tous les jeunes de la planète.
Vitalina Varena
25 mai 2020
Regarder par les fissures
Mathieu Bédard

Gagnant du Léopard d’or lors du dernier festival de Locarno, Vitalina Varela marque le retour sur nos écrans du cinéaste Pedro Costa, l’un des auteurs marquants du « slow cinema ». Fidèle à cette approche, Costa utilise le cinéma depuis plus de 20 ans maintenant pour concentrer l’attention des spectateurs sur la situation alarmante des immigrants cap-verdiens du Portugal. Loin de toute image sensationnaliste, favorisant une approche poétique et contemplative, il affine dans ce dernier opus une démarche basée sur la rigueur et la sobriété de la composition, qui atteint son paroxysme et remet en question du même coup la frontière entre l’esthétique et le politique au cinéma.
Outre leur constance formelle et thématique, la valeur des films de Costa vient aussi de l’ensemble narratif qu’ils tissent pour donner un portrait cohérent de cette communauté. Vitalina Varela reprend ainsi le personnage de Vitalina, qu’on a pu entrevoir dans le précédent Cavalo Dinheiro (2014), et en approfondit le récit. Vitalina est une veuve du Cap-Vert venue au Portugal pour hériter d’un taudis que lui lègue son mari décédé, dont elle n’avait plus de nouvelles depuis plusieurs années. D’entrée de jeu, elle est accueillie à l’aéroport par une parente qui lui annonce qu’elle a raté les funérailles, trois jours plus tôt. Le ton du film est donc celui de l’absence, du deuil et de la rumination. Entre cette situation et les rares conversations que Vitalina entretient avec un prêtre désœuvré, dont la paroisse ne compte plus aucun fidèle, le film déploie des figures où se réfléchit le destin de toute une communauté d’immigrants pour qui la promesse d’un avenir meilleur s’est avérée illusoire. Vitalina, comme ce prêtre, ne peut habiter que les ruines d’un récit colonial, symbolisé par cette maison insalubre et mal construite dont elle hérite malgré elle.
Tout l’intérêt du film repose en fait sur cette dimension symbolique que représente la maison, lieu étouffant dont ni Vitalina ni le spectateur n’arrive à se faire une image mentale précise. Dans cet espace, Costa et son directeur de la photographie, Leonardo Simões, s’attardent avec une méticulosité de peintre à faire de chaque plan un tableau nimbé d’obscurité, dont la composition rappelle les œuvres de Georges de la Tour ou du Caravage. La maison gorgée d’ombres de Vitalina devient un lieu allégorique, situant un espace où les repères se brouillent, à la fois loin de la terre d’origine et inhabitable au sein de la terre d’accueil. Il y a également un lien évident à faire avec Platon, tant cette maison à laquelle l’héroïne est enchaînée paraît obscure, les pièces n’étant souvent éclairées que par les fissures et les crevasses des murs laissant passer la lumière. L’idée que le film n’est pas une œuvre de nuit, mais bien de jour, gagne d’ailleurs le récit peu à peu, qui trouve là une de ses plus belles possibilités, en laissant entendre que cette noirceur n’est qu’un effet de structure masquant le réel, qui s’aperçoit à travers ses failles.
Si, en apparence, la simplicité du dispositif filmique rend Vitalina Varela quelque peu aride, cette rigueur formelle permet en fait d’être habitée plus durablement par les images. Leur vision perdure et nous accompagne longtemps par la suite. Costa court toutefois le risque de gommer les enjeux politiques de son sujet sous cette intention esthétisante, d’autant plus qu’il s’éloigne résolument de la dimension documentaire de ses premières œuvres. Or, comme il revient inlassablement sur ce sujet depuis plus de 20 ans, le film se comprend plutôt comme une méditation que nous offre le cinéaste sur son parcours artistique et sa vision du cinéma. Ce regard réflexif nous confronte ainsi à plusieurs questions importantes : peut-on faire de la misère un motif de beauté, et si oui, quelles sont les limites et les possibilités d’une telle approche ? Raconter le destin des migrants en se référant à une tradition artistique européenne permet-il de remettre « l’Autre » au centre de notre regard, ou est-ce une façon de s’en approprier la figure, tout en réitérant le primat culturel de l’Europe ? Réflexe ou critique postcoloniale, c’est un des mérites de Vitalina Varela que de recadrer ces questions pour en faire des questions proprement cinématographiques, dans une œuvre qui s’avère donc d’une grande actualité.
Conversations entre adultes
20 mai 2020
La crise grecque de 2015 transposée à l’écran
Yves Laberge

C’est une excellente idée que d’avoir porté au grand écran les tenants et aboutissants de la crise grecque de 2015, car celle-ci a en fait ébranlé toute l’Europe. Sans doute le mieux placé pour couvrir ce sujet controversé, Costa-Gavras a adapté le livre Conversations entre adultes : dans les coulisses secrètes de l’Europe, de Yanis Varoufakis, témoin de l’intérieur puisqu’il était alors le nouveau ministre de l’économie du gouvernement grec. Si tout le monde a entendu parler de cette crise financière et politique qui a pratiquement vidé les coffres publics de la Grèce, on ne saurait en expliquer les raisons et en situer les principaux acteurs… pourtant réels. Paradoxalement, c’est le premier long métrage que Costa-Gavras a tourné dans sa Grèce natale après plus d’un demi-siècle d’activité créatrice à l’échelle internationale.
Conversations entre adultes commence en janvier de 2015 par une brève récapitulation des effets de la crise au quotidien : augmentation du chômage et de la pauvreté, désarroi, fermetures des commerces, réduction des salaires, mais surtout, une sorte de tutelle qui faisait en sorte que les ministères de la Grèce ont été envahis par des fonctionnaires étrangers qui voulaient, au nom de l’Union européenne, « assainir » les finances grecques et bloquer l’évasion fiscale. C’est dans ce contexte tendu qu’au début de 2015 un nouveau parti de gauche sera élu en Grèce, au nom duquel Yanis Varoufakis sera envoyé sur tous les fronts en tant que nouveau ministre de l’économie. L’image de rebelle de ce politicien hors-normes a séduit momentanément une partie de l’opinion publique. Mais pour une majorité des médias européens, la Grèce apparaît toujours comme une société éternellement endettée et gaspilleuse, accumulant les dettes et les déficits sans pouvoir s’attaquer aux causes profondes de ce problème chronique.
Avec Conversations entre adultes, le cinéaste franco-grec a trouvé le juste équilibre entre un propos devant être informatif et l’indispensable dramatisation. Il montre subtilement la condescendance, le côté néocolonial des élites et de la bureaucratie dans les institutions européennes. On lui reprocherait seulement son titre trop vague, qui n’indique pas spécifiquement le cas grec ou, plus prosaïquement, le négociateur grec face aux requins de la finance et du Fonds monétaire international (FMI), qui tiennent le gros bout du bâton; tel quel, ce titre pourrait en réalité correspondre à une infinité de sujets très éloignés. Le titre reprend une réflexion de Christine Lagarde, alors directrice générale du FMI, faite à elle-même, dans un moment de chaos : « Nous avons besoin d’adultes dans cette pièce ».
Mais Conversations entre adultes n’est pas qu’un long métrage sur la Grèce; il montre également les disproportions des montants alloués et répartis par la finance, et la mainmise des décideurs du monde de la finance qui tirent les ficelles. Il dénonce aussi les doubles discours, les euphémismes et les poignées de main de façade qui dissimulent à peine des conflits persistants. En outre, on voit les conséquences disproportionnées de ces décisions prises sous la contrainte et qui ont mené à une Grèce bradée et financièrement exsangue.
Peut-on suivre le propos sans une connaissance préalable du contexte ayant mené à la crise ? Assurément. Peut-on apprécier ce film sans maîtriser l’économie et la politique ? Certainement. Parce qu’il montre les jeux de coulisses et qu’il s’inspire de faits réels, on aimerait recommander le film à des cégépiens ou à des étudiants en relations internationales.
Spécialiste des fictions politiques comme Z et L’aveu, Costa-Gavras a de nouveau réussi un film vivant – pour ne pas dire enlevant – sur un sujet pourtant ardu et aride, qui avec quelqu’un d’autre aurait pu mener à l’ennui ou au didactisme. Fort heureusement, la réalisation est efficace grâce à un montage nerveux de Lambis Charalampidis, aidé de Costa-Gavras. Le choix des acteurs est d’une étonnante vraisemblance (sauf pour le personnage de Christine Lagarde). La finale – métaphorique – touche au grandiose. Le sous-titrage en français est efficace pour ce film qui mélange quatre langues. À l’exception de Z, Conversation entre adultes est indéniablement le meilleur long métrage de Costa-Gavras. On espère maintenant qu’il puisse tourner en Grèce un remake de Z (qui ne fut pas tourné en Grèce mais en Algérie), comme il l’avait initialement imaginé.
Prière pour une mitaine perdue
15 mai 2020
Un hiver pour renaître
Catherine Bergeron

Rien ne fait plus mal que perdre – perdre un objet estimé, perdre sa chance, perdre l’amour, perdre un être cher -, car perdre, c’est se perdre soi-même. C’est comme si les piliers patiemment ancrés autour de nous s’écroulaient, et nous ne pouvons réellement continuer d’exister. Ou, du moins, nous ne pouvons continuer sans accepter de se renouveler, se repenser, se reconstruire. Rare sont ceux qui approchent le changement avec excitation et désir. Car rien n’est plus ardu et angoissant que se redéfinir soi-même.
C’est en abordant de front la question de la perte que Prière pour une mitaine perdue (2020), dernier long-métrage documentaire du cinéaste québécois Jean-François Lesage (Un amour d’été, 2015; La rivière cachée, 2017), offre un portrait touchant et humain de la difficulté que nous avons d’avancer. Entre tristesse, nostalgie et espoir, l’œuvre, présentée au festival Visions du réel et au festival canadien Hot Docs, ancre son enquête dans un Québec contemporain où la traditionnelle rude saison de l’hiver ouvre la porte à l’introspection, l’échange, la rencontre et le partage.
Avec son noir et blanc d’un autre temps, Prière pour une mitaine perdue trouve son point de départ dans un lieu des plus banals : le centre d’objets perdus de la Société de transport de Montréal. Image après image, des gens de tous âges et tous horizons s’y succèdent avec, pour point commun, leur désir d’y retrouver un objet perdu, un objet cher, symbolisant quelque chose de beaucoup plus profond. La tristesse et le désespoir marquent le visage de ces personnes anonymes; or elles ne resteront pas anonymes longtemps. En effet, le cinéaste surprend en ce qu’il passe rapidement des locaux de la STM à l’intimité du chez-soi des sujets. Poursuivant son style journalistique, développé depuis ses premières œuvres, il propose des moments d’entrevues lors desquelles les sujets discutent avec leur famille et amis. Dans ces temps de témoignage et de confidence, l’histoire de la perte d’une tuque, d’une photographie ou d’un cartable devient rapidement l’histoire de la perte de parents, d’une amitié, d’une confiance, d’un amour, d’une part d’eux-mêmes. Chez tous, la peine et la perte sont plus profondes, mais tous restent résolus à cohabiter avec elles.
Comme les sentiments qui accablent les sujets, la ville surplombant Prière pour une mitaine perdue est prise dans un blizzard interminable, un blizzard que, étrangement, tous acceptent comme tel. La nuit est noire et la neige blanche tombe encore et encore sur Montréal. Et ainsi, les histoires se superposent sur fond du rude hiver québécois, suprême personnage symbolique à l’œuvre de Lesage. Telle la mitaine perdue du réalisateur, des images de l’hiver ponctuent abondamment la toile narrative, entrecoupant les témoignages. Et, dans cet hiver accompagné d’une musique jazz rappelant les reportages des années 1960 sur la ville et son peuple, les petites gens reproduisent les traditions d’autrefois. L’hiver québécois rime ainsi, ici, avec l’image de citoyens pelletant dans les rues étroites du Plateau, l’image de la jeunesse patinant ou jouant au hockey sur la glace du Parc Lafontaine, faisant de la raquette, de la luge et du ski de fond sur le Mont Royal. Marquée par un romantisme et une nostalgie, l’œuvre ancre volontairement son propos dans un passé spécifique. Ce passé, d’abord stylistique en ce qu’il s’inscrit en filiation avec le cinéma direct québécois (rapprochement avec le sujet, importance de la parole, regard anthropologique sur la manière de vivre des gens), devient l’image d’une perte propre à l’auteur : une perte identitaire, elle aussi bâtie sur de multiples petits symboles.
Dans le Québec contemporain multiculturel de Lesage, la neige pèse sur la ville, mais les déneigeuses, machines du présent, s’affairent interminablement à brasser et redéfinir le paysage. Les personnages regardent peut-être vers le passé, mais le temps reste une force impossible à combattre, les tirant nécessairement vers le changement. Au final, nous voyons tous, propose Lesage, une partie de nous-mêmes dans un tout petit objet sans importance que peut être une mitaine, une tuque ou une photo. Nous y voyons des symboles, des traditions, des traces de ce qui nous définit. Si faire le deuil de ces petits symboles est aussi grand, quel poids représente alors faire le deuil de notre identité? De ce thème difficile, Lesage arrive majestueusement à injecter humour et légèreté, poussant son cinéma dans de nouvelles avenues des plus excitantes. De Prière pour une mitaine perdue résonne ainsi surtout le bonheur de se rencontrer et de partager, et l’importance de reconnaître ce qui nous rassemble tous : notre capacité d’aimer et de vivre le deuil.
Blood Quantum
27 avril 2020
Toujours (mort) vivant
Jason Béliveau

Les attentes étaient élevées pour Blood Quantum, deuxième long métrage du cinéaste Jeff Barnaby. C’est qu’en 2013 nous avions reçu toute une claque – celles non annoncées font le plus de dégâts –, Rhymes for Young Ghouls, fable punk et révisionniste plantée dans l’univers des pensionnats autochtones. Réappropriation d’une histoire bafouée en empruntant les codes du cinéma de genre, Rhymes se brûlait d’avoir à dire, par l’entremise de la fiction, une injustice autrement circonscrite au documentaire. Pourtant, l’influence de ce genre se faisait déjà ressentir, notamment les œuvres engagées de la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin. Pour Blood Quantum, Barnaby s’inspire d’ailleurs librement des Événements de Restigouche (1984), d’Obomsawin, relatant les rafles de la Sûreté du Québec pour empêcher en Gaspésie la pêche au saumon, droit ancestral des Mi’kmaqs.
Nous sommes à la même année de ces rafles, en 1981, dans la réserve de Red Crow, située à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick. Un quotidien sans histoire est perturbé par des événements incongrus : un pêcheur remarque que ses prises éviscérées continuent de gigoter. Un chien exécuté reprend vie, enragé. Le shérif Traylor (Michael Greyeyes) reçoit des appels alarmants. Son fils, Joseph (Forrest Goodluck), âme égarée qui attend un enfant avec sa copine blanche, lui donne également du fil à retordre. Son ex-femme, Joss (la cinéaste Elle-Máijá Tailfeathers, qui a signé le magnifique court métrage Bihttoš), mère de Joseph, tente d’agir à titre de médiatrice. Pour compléter le portrait familial, le demi-frère de Joseph, Lysol (Kiowa Gordon), jeune adulte trouble, traversé d’une colère qui n’attend que d’exploser.
Ce titre, Blood Quantum, intrigue d’emblée. Le blood quantum (« degré de sang » en français) est une mesure controversée du niveau de sang autochtone chez un individu, afin de lui offrir un statut « officiel » d’Autochtone. Pensez au midi-chlorians dans The Phantom Menace, mais avec des répercussions évidemment plus concrètes, touchant l’identité et la descendance. Qualifié à la fois de construction colonialiste et de moyen nécessaire pour préserver les communautés indigènes, il prend ici des connotations positives, ce sang pur rendant immun à une infection transformant les gens en zombies avides de chair fraîche. À mesure que les semaines et les mois s’effritent, la communauté mi’kmaq devient le dernier rempart contre une épidémie qu’on imagine mondiale. Le rapport est inversé : faut-il accueillir les Blancs qui ne sont pas atteints (du moins, pour le moment) et risquer la mort, refuser de leur prêter mainforte, ou carrément les exécuter sans procès ?
L’idée est bonne, et recelait un fort potentiel dramatique, mais son exploitation reste en surface. Au lieu de creuser le commentaire attendu sur des siècles de colonialisme, Barnaby préfère faire des références faciles au Robert Rodriguez de From Dusk Till Dawn et à Tarantino. Exemple : au lieu de les appeler « zombies » (la convention du genre veut qu’on ne les qualifie jamais de ce nom), les survivants préfèrent le terme « zeds », ce qui occasionnera un gag que n’importe quel amateur de Tarantino aura vu venir de loin. Il n’est pas question de critiquer ce plaisir de rendre hommage, de jouer avec la glaise, de s’offrir des orgies de boyaux de sang (les effets spéciaux, signés par les Blood Brothers, sont glorieusement juteux), mais le peu de développement narratif et de complexité psychologique laisse sur sa faim.
Forcément subversif le film de zombies ? Avec la pléthore d’allégories sociopolitiques venues vider le genre de ses entrailles depuis une vingtaine d’années, nous le sentons de plus en plus maintenu artificiellement en vie. Blood Quantum confond malheureusement concept et profondeur. Bien que nous accueillions à bras ouverts son désir de n’être parfois qu’un bête divertissement de série B, ses écueils scénaristiques et une direction d’acteurs aléatoire résultent en une tentative honnête, bien que manquée, de tirer son épingle d’un jeu dont on ne connaît que trop bien les règles.