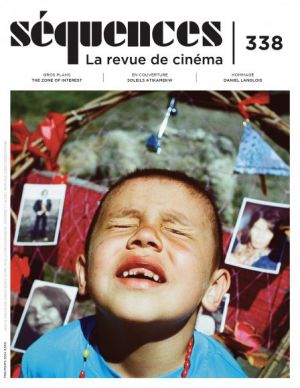Articles récents
Norbourg
21 avril 2022
The Wolf of boulevard René-Lévesque
Guillaume Potvin

Presque vingt années nous séparent de la fondation et de la faillite de l’entreprise de gestion de fonds de placement Norbourg (1998-2005). Bien que la firme ait été hautement médiatisée depuis ses débuts — des publicités vantant son intégrité étaient diffusées régulièrement à la télévision et son directeur général, Serge Beugré, animait une chronique au canal Argent —, c’est seulement au moment des perquisitions effectuées par la GRC, le 25 août 2005, que Norbourg est devenu tristement célèbre.
Curieux qu’il a fallu si longtemps avant que l’histoire soit portée au grand écran, car l’encre qu’a fait couler le coup d’éclat remplirait probablement une piscine olympique. On a publié d’innombrables articles au cours de l’enquête officielle qui, elle aussi, a généré des milliers de pages de témoignages. Le journaliste Yvon Laprade et l’ancien directeur des communications de la firme Philippe Terninck ont d’ailleurs tous deux écrit des livres sur la saga. Manifestement, le cas Norbourg a fasciné le public et a inspiré nos artistes. En 2008, le chasseur de lagopèdes de Robert Morin ne faisait pas que partager le prénom de Vincent Lacroix, il était comme lui un arnaqueur en cavale. Si ce dernier s’avérait tout de même sympathique, la critique de Morin a par la suite redoublé d’ardeur dans Un paradis pour tous en insistant sur le caractère abject des bandits à cravate.
Bref, tous s’entendent pour dire que Lacroix est un beau crosseur. Mais outre ce sentiment de dégoût et d’injustice généralisé, quel est l’intérêt du scandale Norbourg au-delà du fait divers ? Quel est le drame au cœur de cette histoire ? Non pas au sens tragique — les 115 millions de dollars soutirés aux 9 200 petits épargnants québécois parlent d’eux-mêmes —, mais bien au sens dramaturgique ? Sincèrement, à ce stade, la question se pose. Que reste-t-il à dire sur cette affaire ? Quel nouveau regard pouvons-nous y porter ?
Avec un duo de créateurs aussi chevronnés que Maxime Giroux et Simon Lavoie à la tête du projet et le recul historique engendré par la conclusion juridique de l’affaire, Norbourg a tout pour piquer la curiosité. L’agencement de la sensibilité humaniste de Giroux pour les personnages troublés et opaques (Jo pour Jonathan, Félix et Meira) avec les questionnements nationalistes de Lavoie (Le déserteur, Laurentie, Le torrent, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau) ainsi que leur fascination commune pour le nihilisme ambiant, voire même l’eschatologie (La grande noirceur, La petite fille qui aimait trop les allumettes, Nulle trace) annonçait une première collaboration gagnante.
D’entrée de jeu, on remarque dans Norbourg un choix scénaristique plutôt inspiré : Lavoie aborde le récit du point de vue d’Éric Asselin, le vérificateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui quittera ses fonctions pour devenir l’acolyte principal de Vincent Lacroix. C’est une stratégie au potentiel dramatique intéressant car elle permet d’exposer les informations pertinentes par rapport à Norbourg et son fondateur au fur et à mesure que le personnage les découvre. Mais l’impact dramatique des découvertes incriminantes d’Asselin tombe à plat, à moins que l’on soit complètement ignorant du scandale.
S’ajoute à cela une caractérisation des personnages plutôt mince qui les rend unidimensionnels et inintéressants. En ce sens, l’intelligence d’Asselin, le prétendu « cerveau » de l’opération, est peu convaincante. Il faut mentionner que, outre son ampleur, la fraude effectuée par Norbourg n’a rien de particulièrement novateur. Pour représenter leurs crimes, on enchaîne les séquences de montage montrant des méthodes comme l’usurpation de signatures, la contrefaçon de télécopies, courriels et relevés de transactions, le passage d’enveloppes brunes et un nombre ridicule de plans d’écrans informatiques affichant des chiffres sans signification narrative remplacés par d’autres chiffres tout aussi insignifiants.
Néanmoins, il faut admettre que l’abstraction est la nature même des crimes de cols blancs : on manipule les données pour que celles-ci mentent à notre place. Si c’est probablement ce qui aide leurs auteurs à se déculpabiliser, c’est aussi ce qui complexifie leur explication et leur représentation. Norbourg tente de résoudre ce problème en personnifiant les conséquences de ces trafics de fonds par l’entremise du personnage de Jean-Guy Houle, mais les quelques apparitions de cette célèbre victime sont au service d’un pathos superflu.
Norbourg n’est toutefois pas sans qualité. La direction photo (assurée par Sara Mishara, qui jette ici un tout autre regard sur le centre-ville de Montréal qu’elle l’avait fait dans Les oiseaux ivres) est franchement remarquable. Les cadrages enserrant l’équipe de Norbourg de tous côtés par des façades vitrées — tantôt transparentes, tantôt réfléchissantes — traduisent efficacement le tiraillement entre leur désir d’exhiber leur statut et la crainte que leur imposture soit découverte. Bien que Lacroix se montre très confiant, certains plans en contre-plongée rappellent qu’il n’est en fait qu’un petit joueur dans le monde de la haute finance, les gratte-ciel avoisinants le surplombant tels des Léviathans menaçants. Dans une scène au dernier étage d’un stationnement, la mise en scène et le découpage accentuent la distance qui se creuse entre Lacroix et Asselin peu de temps avant que les rouages de la justice se mettent à tourner.
Dommage que ces scènes si bien réalisées ne parviennent pas à sauver l’ensemble. Ce à quoi semble se buter Norbourg n’est rien d’autre que les limites mêmes du réalisme narratif; on sent constamment le poids de l’« Histoire officielle » sur l’œuvre. Elle pèse si lourd qu’elle empêche le film de réellement décoller. Par le fait même, on perçoit là une occasion manquée d’explorer les aspects curieux et uniques du cas : le caractère spectaculaire de la compagnie, la tentative par Lacroix de contrôler la perception publique de l’affaire, sans parler de ce que le scandale Norbourgpermet de révéler sur le fonctionnement du monde. Si Giroux et Lavoie ont des idées à ce sujet, elles ne sont prononcées qu’à demi-mot : le financement et les ressources des institutions d’encadrement économique sont insuffisants, la déréglementation est l’arme principale du néolibéralisme, la restructuration de la Commission des valeurs mobilières du Québec a profité aux riches et l’élection des libéraux de Jean Charest en 2003 n’aura fait qu’accélérer la fragilisation de notre système public. Qui n’était pas déjà convaincu que Vincent Lacroix est un salaud de première classe ? À l’ombre d’un retour en politique possible de Charest qui plane à l’horizon, on aurait espéré que notre Wolf of Wall Street ait des crocs plus acérés.
No 330 – Les tribulations d’un aspirant court métragiste
18 avril 2022

J’ai réalisé un court métrage. Vous n’en avez probablement jamais entendu parler et c’est très bien comme ça. Pas qu’il soit particulièrement gênant. Il a fait deux ou trois festivals, on m’en a parfois dit du bien, j’ai parfois cru déceler qu’on en pensait du mal. Mes expériences de critique et de programmateur m’ont heureusement prémuni des craintes que doivent partager la plupart des artistes au moment d’exhiber leur « p’tit dernier ». Mon distributeur l’a vendu à la télévision et au Web, et continue — à ma grande surprise — de m’envoyer, de temps à autre, un chèque. Pour un premier film produit et réalisé de manière indépendante, sans grands moyens, les bénéfices ont été, toute proportion gardée, respectables. Assez pour alimenter le désir d’en faire un deuxième. Mais il ne s’est rien passé, sinon l’inexorable cours de la vie. Les semaines de réflexion et d’hésitation sont devenues des mois; les mois, des années. D’autres projets, dont cette revue, ont pris l’avant-scène, reléguant cette « volonté » de faire du cinéma aux mêmes tiroirs qui accueillent depuis mon adolescence mes pires idées de scénario.
J’écris « volonté » entre guillemets parce que je n’ai jamais particulièrement voulu être un réalisateur. Mais l’idée de faire un film m’avait toujours — à différents degrés d’insistance — trotté dans la tête. À l’aube de la trentaine, j’ai senti que c’était le moment ou jamais. Peu importe qu’il soit génial. Peu importe qu’il soit mauvais. Peu importe qu’il m’apporte la gloire éternelle ou me foute la honte à jamais, j’allais faire un film ! Il ne me restait plus qu’à l’écrire, qu’à arrêter mon choix sur une équipe de techniciens chevronnés, qu’à sélectionner des comédiens (le plus important), qu’à établir un horaire de tournage (et convaincre des gens pratiquement bénévoles de se lever à 6 h du matin un samedi pour tourner l’histoire de deux jeunes adultes qui vont peut-être tomber en amour dans un appartement… la joie !), qu’à le tourner, qu’à gérer sa postproduction, qu’à le terminer pour de bon et lui trouver un distributeur. Et tout ça, avec mes économies. Mais ce capharnaüm n’est rien quand tu vois déjà ton nom et celui de ton film dans les programmes des plus prestigieux festivals de courts métrages du monde. Les étoiles dans les yeux, comme on dit.
Je parle de tout ça parce que le numéro que vous tenez dans vos mains est consacré au court métrage au Québec. J’en parle parce que, un matin de novembre de 2017, une équipe de tournage les yeux un peu collés a attendu que je lance le premier « Action ! » d’un projet assez fou et insensé, mais qui existe aujourd’hui. J’ai le lien Vimeo pour vous le confirmer. J’en parle parce que je sais parfaitement ce que ça exige d’effort et de sueur, de fatigue et d’incertitude, de faire un film. Pendant un très bref laps de temps, j’ai fait partie de la bande. « One of us, one of us, » chantaient en cœur les bêtes de foire dans Freaks de Tod Browning. Parce que, oui, les gens qui font du cinéma sont anormaux. Hypothéquer sa santé mentale et physique pour raconter des histoires ? Oui oui, rien de plus sensé !
En admettant que Minuit à l’oasis (c’est le titre de mon court, ça) soit ma seule aventure dans le merveilleux monde de la mise en scène, qu’en ai-je retenu ? Difficile à dire. Suis-je aujourd’hui un meilleur critique et programmateur d’avoir saisi, par l’expérience, que même le plus modeste petit court métrage du monde ne peut se faire sans un minimum de passion ? La passion suffit-elle à rendre une œuvre importante, bonne, ou même modérément divertissante ? Est-ce que tous les membres de l’Association québécoise des critiques de cinéma devraient au moins réaliser un court métrage avant de recevoir leur carte de membre, question de mettre les choses en perspective ? Je sais que cela a été pour moi un incroyable exercice d’humilité. Je sais surtout que l’expérience a ravivé la flamme du cinéphile en moi. Je sais que, mesurant mieux l’énergie nécessaire pour réussir un simple et bête champ-contrechamp, chaque film est, au fond, un petit miracle en soi. Même les courts métrages que vous ne verrez probablement jamais.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
La semaine de la critique de la Berlinale 2022, une épopée cinématographique
1er mars 2022
La semaine de la critique de Berlin nous présente des œuvres étranges et déroutantes, aux propositions cinématographiques expérimentales. Les réalisateurs n’hésitent pas à mettre au rebut les techniques classiques pour se confronter, et plus encore, nous confronter, à de nouvelles façons de raconter des histoires. Replaçant au centre de leurs créations le pouvoir des images, les cinéastes s’abrogent de toute linéarité narrative et ouvrent la porte au flux infini des couleurs, des sons, de ces moments de vies capturé par leurs caméras. Avec Notes for a Déja Vu, le collectif mexicain Los Ingrávidos nous propose une accumulation d’images d’archives, métaphore des souvenirs qui s’amoncellent dans nos mémoires. La voix off répète inlassablement « memories are gone but images are here ». Alors que les souvenirs s’effacent, les images, gravées sur la pellicule, demeurent, à l’abri des affres du temps. La caméra devient une boîte à fantômes encapsulant les âmes à travers son objectif.

Les grands mythes de la littérature sont également remis au goût du jour, de manière plus trash, plus colorés, plus sexuels aussi. De Nosferatu à Orphée, en passant par des adaptations de Shakespeare ou encore de Bukowski, c’est une réflexion sur l’art en général qui nous est proposée ici. Intitulée « Mythunderstanding », la catégorie rassemblant le film Love is a Dog From Hell de Khavn de la Cruz et Sycorax de Lois Patiño et Matías Piñeiro, nous montre que le cinéma lui-même est créateur de mythes. Les images se mêlent et s’entremêlent, les couleurs se déchaînent, la musique exulte et accompagne l’errance de nos personnages. Tous ces films ont la particularité de nous offrir un voyage à travers l’espace et le temps, à la recherche d’une quintessence, d’un art fait de sensation et d’émotions. Parfois hermétiques et obscures, certaines œuvres peinent à nous embarquer dans leurs univers délirants, mais elles soulignent toutefois l’horizon immense, aux régions encore inconnues, que forme le cinéma. S’il faut s’accrocher pour se laisser entraîner, les propositions sont tellement étonnantes que nous nous prêtons au jeu, cherchant à comprendre messages cachés et références implicites.
La semaine de la critique de Berlin nous sert sur un plateau des films engagés, disséquant les images pour en extraire la substantifique moelle, celle qui fait de l’art une entité toujours en mouvement, toujours expérimentant, celle qui fait du cinéma le septième art et non pas un simple divertissement.
CAMILLE SAINSON