Mot de la rédaction
No 330 – Les tribulations d’un aspirant court métragiste
18 avril 2022

J’ai réalisé un court métrage. Vous n’en avez probablement jamais entendu parler et c’est très bien comme ça. Pas qu’il soit particulièrement gênant. Il a fait deux ou trois festivals, on m’en a parfois dit du bien, j’ai parfois cru déceler qu’on en pensait du mal. Mes expériences de critique et de programmateur m’ont heureusement prémuni des craintes que doivent partager la plupart des artistes au moment d’exhiber leur « p’tit dernier ». Mon distributeur l’a vendu à la télévision et au Web, et continue — à ma grande surprise — de m’envoyer, de temps à autre, un chèque. Pour un premier film produit et réalisé de manière indépendante, sans grands moyens, les bénéfices ont été, toute proportion gardée, respectables. Assez pour alimenter le désir d’en faire un deuxième. Mais il ne s’est rien passé, sinon l’inexorable cours de la vie. Les semaines de réflexion et d’hésitation sont devenues des mois; les mois, des années. D’autres projets, dont cette revue, ont pris l’avant-scène, reléguant cette « volonté » de faire du cinéma aux mêmes tiroirs qui accueillent depuis mon adolescence mes pires idées de scénario.
J’écris « volonté » entre guillemets parce que je n’ai jamais particulièrement voulu être un réalisateur. Mais l’idée de faire un film m’avait toujours — à différents degrés d’insistance — trotté dans la tête. À l’aube de la trentaine, j’ai senti que c’était le moment ou jamais. Peu importe qu’il soit génial. Peu importe qu’il soit mauvais. Peu importe qu’il m’apporte la gloire éternelle ou me foute la honte à jamais, j’allais faire un film ! Il ne me restait plus qu’à l’écrire, qu’à arrêter mon choix sur une équipe de techniciens chevronnés, qu’à sélectionner des comédiens (le plus important), qu’à établir un horaire de tournage (et convaincre des gens pratiquement bénévoles de se lever à 6 h du matin un samedi pour tourner l’histoire de deux jeunes adultes qui vont peut-être tomber en amour dans un appartement… la joie !), qu’à le tourner, qu’à gérer sa postproduction, qu’à le terminer pour de bon et lui trouver un distributeur. Et tout ça, avec mes économies. Mais ce capharnaüm n’est rien quand tu vois déjà ton nom et celui de ton film dans les programmes des plus prestigieux festivals de courts métrages du monde. Les étoiles dans les yeux, comme on dit.
Je parle de tout ça parce que le numéro que vous tenez dans vos mains est consacré au court métrage au Québec. J’en parle parce que, un matin de novembre de 2017, une équipe de tournage les yeux un peu collés a attendu que je lance le premier « Action ! » d’un projet assez fou et insensé, mais qui existe aujourd’hui. J’ai le lien Vimeo pour vous le confirmer. J’en parle parce que je sais parfaitement ce que ça exige d’effort et de sueur, de fatigue et d’incertitude, de faire un film. Pendant un très bref laps de temps, j’ai fait partie de la bande. « One of us, one of us, » chantaient en cœur les bêtes de foire dans Freaks de Tod Browning. Parce que, oui, les gens qui font du cinéma sont anormaux. Hypothéquer sa santé mentale et physique pour raconter des histoires ? Oui oui, rien de plus sensé !
En admettant que Minuit à l’oasis (c’est le titre de mon court, ça) soit ma seule aventure dans le merveilleux monde de la mise en scène, qu’en ai-je retenu ? Difficile à dire. Suis-je aujourd’hui un meilleur critique et programmateur d’avoir saisi, par l’expérience, que même le plus modeste petit court métrage du monde ne peut se faire sans un minimum de passion ? La passion suffit-elle à rendre une œuvre importante, bonne, ou même modérément divertissante ? Est-ce que tous les membres de l’Association québécoise des critiques de cinéma devraient au moins réaliser un court métrage avant de recevoir leur carte de membre, question de mettre les choses en perspective ? Je sais que cela a été pour moi un incroyable exercice d’humilité. Je sais surtout que l’expérience a ravivé la flamme du cinéphile en moi. Je sais que, mesurant mieux l’énergie nécessaire pour réussir un simple et bête champ-contrechamp, chaque film est, au fond, un petit miracle en soi. Même les courts métrages que vous ne verrez probablement jamais.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
No 329 – Travelling avant sur le Château Frontenac, en contre-jour
11 janvier 2022

Laissez-moi vous parler de Québec. Ces temps-ci, la région de la Capitale-Nationale fait la manchette, mais pour des raisons qui sont très éloignées du cinéma (ceci étant dit, je verrais bien dans quelques années un film sur le troisième lien dans l’esprit de Réjeanne Padovani de Denys Arcand).
Une petite mise en contexte s’impose, qui vous fera comprendre qu’il est ici question — à peine, à peine — de chauvinisme pleinement assumé. Bien que la majorité de son équipe habite Montréal, Séquences est une revue dont les bureaux sont situés dans l’une des plus vénérables et anciennes institutions de Québec. Pour ma part, j’habite les divers quartiers de son arrondissement La Cité-Limoilou depuis une quinzaine d’années.
Québec est une ville carte postale, c’est bien connu, mais elle est étrangement peu présente sur les grands écrans. Elle demeure néanmoins le décor d’un grand classique du cinéma, I Confess d’Alfred Hitchcock (1953), accueilli tièdement à sa sortie en salle aux États-Unis, encensé quelques mois plus tard en France, notamment par Jacques Rivette dans Les cahiers du cinéma. Le synopsis, tout simple, est diablement efficace : le père Logan (Montgomery Clift) choisit de taire l’identité d’un tueur, étant lié à celui-ci par le secret de la confession. Par subterfuge, l’assassin portait une soutane la nuit du crime. Logan devient ainsi le principal suspect de l’affaire. Mais cet homme de Dieu, d’apparence noble, est loin d’être sans reproche.
Nous sommes en terrain connu : le film est un exemple parfait du concept de transfert de culpabilité qui consume le cinéaste (Strangers on Train et The Wrong Man étant deux autres exemples probants). Son utilisation de l’architecture particulière du Vieux-Québec est conséquente, les rues étroites et tortueuses du quartier formant un dédale escherien où toute ligne de fuite se bute à un mur. Aucune issue n’est possible pour le père Logan. Nous baignons en plein cauchemar expressionniste. Pour l’habitant.e de Québec, un jeu s’ajoute à celui qu’Alfred orchestre pour notre plaisir de cinéphile : celui qui consiste tracer une carte fidèle des lieux défilant à l’écran, alors que, bien entendu, l’espace filmique est ici constitué d’un amalgame de décors bigarrés et éloignés les uns des autres.
Hitchcock a plus tard répudié I Confess pour son manque d’humour. Bien qu’il soit effectivement l’un des films les plus arides du maître du suspense, il concentre magnifiquement ses obsessions et se termine sur une scène iconique à l’intérieur du Château Frontenac. Cette comète a laissé une trace indélébile sur la ville, au point qu’un p’tit gars d’ici, et pas des moindres, en a fait le point de départ d’un premier film qui, j’oserais dire, le surpasse en tout point. Le confessionnal de Robert Lepage a réussi à extirper toute la québécitude du film de la Warner Bros. : l’influence de l’Église sur les ménages d’alors, la complicité du gouvernement duplessiste, la culpabilité typiquement catholique. Ce récit parallèle, campé dans les années 1950 et 1980, au-delà des tours de passe-passe chers à Lepage, forme une réflexion fascinante sur la façon dont les Québécois.e.s se perçoivent dans l’œil de « l’Autre ». Présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 1995 (accompagné d’Eldorado de Charles Binamé), succès critique incontestable, déjà qualifié de classique de notre cinéma national à sa sortie en salle, il est la plus grande réussite cinématographique tournée à Québec.
Cut to un demi-siècle plus tard. Québec continue de se faire timide sur les grands écrans. Sa dernière apparition notable à l’international est dans Catch Me If You Can de Steven Spielberg (2002), où la place Royale se substitue à Montrichard en France le temps d’une scène inoubliable opposant Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Plus récemment, on est venu y tourner des miniséries sud-coréenne (Goblin) et américaine (Barkskins). Même dans le cadre de productions québécoises, elle se fait rare. Depuis Les Plouffede Gilles Carle en 1981, production pharaonique d’une incontestable qualité, on pourrait noter Tout ce que tu possèdes de Bernard Émond (2012), tourné dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, et quelques scènes des films de la série 1981 de Ricardo Trogi, originaire du coin.
Plus récemment, le cinéaste de Québec Samuel Matteau a réussi, avec son premier long métrage Ailleurs (2017), à extirper notre ville de ses poncifs et d’en faire une entité étrange et mystérieuse, nourrie par son histoire et son architecture unique. Rien que pour ce pari relevé, le film mérite d’être vu. Mais autrement, Québec est encore à réfléchir cinématographiquement. Les possibilités sont infinies.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
No 328 – Se passer de commentaires
27 septembre 2021
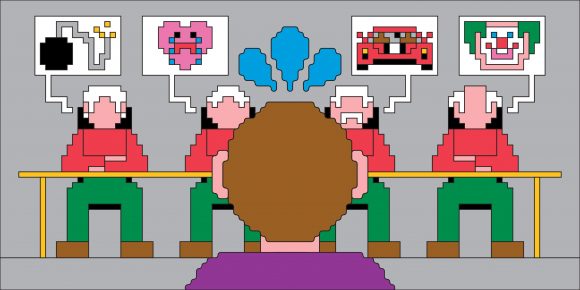
En guise de couperet, difficile d’imaginer phrase plus équivoque :
« Le jury a questionné la place de l’humour dans le thème de la quête identitaire d’un personnage métissé [sic]. »
Cette remarque, cryptique s’il en est, a été adressée récemment à Nicolas Krief, coscénariste de Jusqu’au déclin et réalisateur des courts métrages Skynet et Opération Carcajou, en réponse à projet de court métrage déposé au Conseil des arts et des lettres du Québec. Krief, né d’un père tunisien et d’une mère québécoise (donc métis, faut-il bêtement le souligner), l’a partagée publiquement en ligne, se contentant d’y ajouter un succinct « Y a encore du chemin à faire les potes, beaucoup de chemin ».
Notez que le jury n’a pas mis en doute l’humour en soi (est-ce drôle ?), mais la place de l’humour (peut-on/doit-on en rire ?) dans la quête identitaire d’un personnage métis. Le terme est galvaudé, mais il faut se prêter à d’étonnantes circonvolutions mentales pour ne pas considérer comme problématique cette position qui — et je cite à nouveau Krief, cette fois-ci dans une conversation que nous avons eue en privé — « invalide la démarche de l’auteur et se trouve à l’opposé des mesures que devraient entreprendre les institutions de financement qui veulent diversifier notre cinéma. Le danger avec un tel commentaire, c’est qu’il peut décourager, par exemple, une ou un cinéaste de la diversité de soumettre à nouveau son projet, ou même de poursuivre sa carrière artistique. » Cette question mériterait à elle seule tout un texte, mais je ne me sens pas assez outillé pour la développer adéquatement. Elle illustre tout de même dans le particulier un sac de nœuds que tous les cinéastes québécois devront tôt ou tard se coltiner : le retour des comités d’évaluation sur leurs projets de film.
Sans aucune prétention statistique, j’ai sondé il y a quelques semaines mon entourage dans le milieu : « Quelles sont les remarques les plus absurdes que vous avez reçues de la part de la SODEC, du CALQ, de Téléfilm Canada, par rapport à un scénario déposé ? » En quelques minutes, j’étais enseveli sous des dizaines de témoignages. Quelques critiques rapportées me sont apparues anodines, dans certains cas défendables. La majorité m’a rendu perplexe. Une ou deux m’ont carrément mise en colère. Par acquit de conscience, je n’en partagerai aucune ici, mais leur accumulation m’a rapidement démontré l’absurdité bureaucratique qui sous-tend toute évaluation d’œuvres artistiques (le cœur) par des entreprises dites culturelles (les poches).
L’opposition est facile : les pauvres créateurs incompris d’un côté, les méchants fonctionnaires de l’autre. Mais comment ne pas être le moindrement en colère de voir un scénario sur lequel on a planché durant des mois prendre le dalot pour des raisons en apparence insensées ? Vous me direz que si leur scénario avait été accepté, jamais ces artistes ils ne se plaindraient. Ce n’est pas faux. Et quel cinéaste établi n’a pas des tiroirs qui débordent de films avortés ? Stanley Kubrick n’a-t-il jamais pu tourner sa biographie rêvée de Napoléon ? Au Québec, Robert Morin vient de publier aux éditions Somme toute un recueil de trois scénarios tablettés (Scénarios refusés, notre recension en p. 50). Au moment de la mort en août dernier de Rock Demers, Radio-Canada nous rappelait dans sa notice nécrologique que le plus grand regret du créateur des Contes pour tous a été de ne pouvoir mettre à terme, à la fin de sa vie, un projet de film mettant en vedette un personnage autochtone. La SODEC avait refusé de le financer.
Il demeure facile de lancer des pierres sur des cibles qui ne peuvent se défendre, de juger a posteriori de « mauvaises » décisions, de sermonner des comités d’avoir dormi, par exemple, sur un talent comme celui de Myriam Verreault, qui a dû attendre dix ans après À l’ouest de Pluton pour enfin réaliser Kuessipan. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans les bottines de celleux qui siègent sur ces comités maudits, de ces jurés qui doivent lire attentivement, trier, soupeser, juger, trancher. Épineux, non ? J’irais même jusqu’à avancer qu’il n’y a pas de poste plus ingrat dans toute notre industrie. Cette autorité césarienne qui, sur un dix sous, peut assurer ou mettre fin à la carrière d’un cinéaste, peu doivent l’accueillir sans être conscients de son poids, des responsabilités qu’elle incombe.
Aucun système n’est parfait. Pour cela, il faudrait financer tout le monde sans distinction. Instaurer un système par ordre alphabétique, un tirage au sort. Une chasse aux œufs de Pâques, tiens. Quoique, nous ne sommes déjà plus très loin de la réalité. Mais admettre les failles inhérentes à la présente façon de procéder ne signifie pas pour autant accepter sans broncher les aberrations comme celle qu’a dû essuyer Nicolas Krief, nonobstant les qualités intrinsèques de son projet de film.
Dans ces cas, mieux vaut encore se passer de commentaires.
JASON BÉLIVEAU — RÉDACTEUR EN CHEF
No 327 – Le secret des dieux
7 juillet 2021

Dans les dernières semaines, j’ai entendu mon lot d’histoires qu’on m’a sommé de ne pas ébruiter. Parfois des ragots, dans certains cas des rumeurs sans grande importance, souvent des témoignages consternants de la bouche de principaux témoins ou concernés. Assez pour se lancer gaiement dans l’écriture d’un petit Livre noir du cinéma québécois. Vous me direz que c’est comme ça dans tous les milieux. Il y a l’histoire officielle, celle des communiqués de presse et des réseaux sociaux, puis celle officieuse, faite de teintes grises et de détails croustillants, qui circule de façon aléatoire, selon le principe du téléphone arabe, au point qu’il peut être tout autant risqué de s’y fier lorsqu’elle parvient à ses oreilles. L’être humain adore colporter des histoires et être le dépositaire de secrets bien gardés ! Ne mentez pas, vous aussi avez déjà ressenti ce petit frisson lorsque sont prononcés ces mots en apparence naïfs : « Garde ça pour toi, mais j’ai entendu dire que… »
Aucun scoop digne d’Échos vedettes ne vous sera ici dévoilé. Ce n’est ni le lieu ni l’endroit. En toute franchise, la plupart du temps je préférerais ne pas être mis au courant de ce qui se trame dans les coulisses de l’industrie et n’avoir qu’à me concentrer sur le contenu des films à couvrir, à décortiquer et à mettre en lumière. Les critiques ont-ils à se mêler de ce genre d’intrigues ? Ce qui revient à poser cette sempiternelle question : à quel point peuvent-ils fricoter en toute impunité avec cinéastes, programmateurs et comédiens ? Pauline Kael, c’est bien connu, soupait volontiers avec les cinéastes qu’elle appréciait et défendait. D’un autre côté et plus près d’ici, Robert Lévesque soutient que, dans ce métier ingrat, il faut être « l’allié de personne ». Où trancher ? Et il est particulièrement difficile, vu la taille du Québec, de ne pas moindrement « se fréquenter ». D’autant plus que le critique doit plus que jamais diversifier son porte-folio. Ceux qui gagnent ainsi leur vie ne sont pas légion; on peut sûrement les compter sur les doigts d’une main et ils travaillent dans deux ou trois médias de masse. Autrement, il faut s’organiser, en devenant programmateurs, enseignants, directeurs de festival, scénaristes, éditeurs, animateurs de cinéclubs. Le critique est partout et, qu’il le veuille ou non, finit toujours par tout savoir.
Alors, il fait quoi avec ce qu’il sait, le critique ? Surtout lorsqu’il détient des informations qu’il considère comme d’intérêt public ? Des informations qui touchent des organismes et festivals subventionnés ? Savoir sans agir reviendrait-il à cautionner des largesses, des manquements à l’éthique ? Je connais plusieurs critiques qui préfèrent garder profil bas et se concentrer sur les films, faisant fi de leurs tenants et aboutissants. Et ils ne sont pas à blâmer, leur travail étant déjà assez compliqué comme ça ! Mais force est d’admettre que nous sommes parfois bien envoûtés devant les images qui dansent sur nos écrans, au point d’oublier qu’il n’y pas que les films qui sont tissés d’illusions.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
No 326 – L’œil qui pétille
30 mars 2021
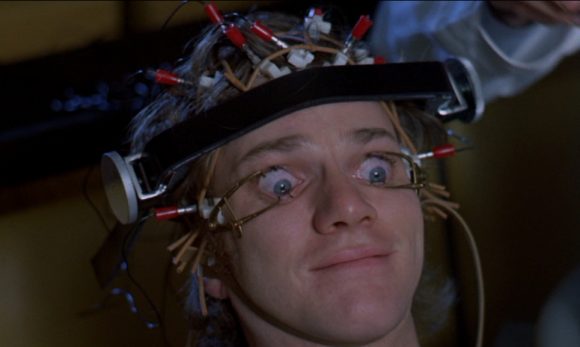
Je me suis lancé comme défi cette année de voir tous les films du top 100 du British Film Institute. Ce palmarès, créé en 1952 et mis à jour tous les dix ans, fait figure d’évangile; vous pouvez le remercier si vous savez sans le savoir que Citizen Kane est « the greatest film of all time », (Vertigo lui a par contre ravi sa palme en 2012). Petite crème apaisante sur l’anxiété : j’ai vu la majorité des entrées de cette liste canonique (76 % au moment d’écrire ces lignes). Il y a encore quelques omissions gênantes au tableau de chasse (La dolce vita, Ugetsu) et certains films seront revus pour dissiper toute incertitude (ai-je vu cet Ozu, ou le confonds-je avec un autre ?), mais dans l’ensemble, l’exercice n’est pas que profitable, il est également hautement réjouissant.
Épaulé par Letterboxd, je dissèque donc avec une attention maladive la plus insignifiante évolution dans mes statistiques de visionnement. Réseau social des cinéphiles, Letterboxd permet à ses abonnés et abonnées payants d’accéder à un nombre considérable d’informations relatives aux films qu’ils ont vus. Les plus prédisposés – et j’en suis – peuvent ainsi se repaître dans une abondance d’informations toutes les plus superflues les unes que les autres. Par exemple, je peux vous nommer l’actrice dont j’ai vu le plus de films en 2017 (France Castel – les perspicaces comprendront que j’avais vu beaucoup de Forcier) et celui de mon studio américain chouchou en 2020 (Paramount). Je peux vous dire que dans ma vie j’ai vu 33 Scorsese, 14 Mike Leigh et 11 Shōhei Imamura. Que ma décennie favorite est celle des années 1950. Que j’ai vu sept films thaïlandais, autant d’égyptiens, mais encore aucun de l’Afghanistan. Et ainsi de suite, à en faire somnoler Paul Houde. Chaque clic sur une année, un réalisateur, une directrice de la photographie ou un comédien fait défiler un cortège infini de nouveaux films insoupçonnés et intrigants. C’est le jeu de la taupe, mais chaque coup de mailloche est en fait un coup d’épée dans l’eau.
Comment pourrais-je satisfaire une bonne fois pour toutes le cinéphile en moi ? Que d’heures mal investies au fil des ans ! Je dois m’activer et entraîner mon muscle cinéphile. Fini les écarts de conduite, fini les facilités, je délaisse les plateformes aisément accessibles au profit des coins les plus malfamés d’Internet. Je veux du rare, de l’introuvable, du difficile mais nourrissant, des perles : un lien torrent d’un obscur pinku eiga, un coffret DVD bootleg des œuvres de Straub-Huillet, un .mov d’un Jonas Mekas partagé par un ami via WeTransfer. Les pupilles dilatées, devenues des trous noirs absorbant toute lumière, je suis le monstre du Voyage de Chihiro à l’appétit vorace. Je dois parachever mon œuvre de visionnement ! Tout voir sans distinction ! Tous les muets de Lubitsch, tous les westerns de la Republic Pictures, tous les films en Technicolor trichrome, tous les Police Academy ! Vingt-quatre images par seconde ? J’en veux le double, le triple ! L’intégral du septième art dans ma mémoire vive, branché dans mes veines ! Et quand j’aurai tout vu, tel un roi fou régnant sur un royaume désert, seulement là pourrai-je m’assoupir l’esprit tranquille. En attendant vous m’excuserez, mais je vous quitte pour aller voir Sunrise de Murnau.
Pouvez-vous croire que je ne l’ai jamais vu ?
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
No 325 – Fatigue et enchantement
6 janvier 2021

Il faut s’organiser. Je me suis installé un bureau à l’étage de mon appartement. Peinture aux teintes apaisantes, lampe murale et chandelles IKEA, la totale. Entouré de piles de magazines et de livres, structures vacillantes et précaires, je réponds à mes courriels, assiste à d’inéluctables réunions Zoom, vois mes journées s’égrener au rythme de courts métrages que j’écoute pour le travail, un premier avec le café matinal, un deuxième sur l’heure du dîner, un troisième en fin d’après-midi, un dernier en soupant. Les apôtres de l’ultralibéralisme et de l’autorégulation des marchés peuvent dormir sur les deux oreilles : le confinement rend productif. À vrai dire, je ne l’ai probablement jamais autant été, productif, chaque minute étant réfléchie et investie en fonction des menues tâches à accomplir. Manufacture d’objectifs à rayer de mon cahier Rhodia, ce minuscule espace circonscrit mon existence pandémique, et malgré l’épuisement certain, celui de ne pas savoir, ou de ne pas pouvoir savoir, j’y suis tout de même bien.
Le soir, je lis. Black Light. Pour une histoire du cinéma noir et Joan Crawford. Hollywood Monster, publiés par l’excellent distributeur français Capricci. L’essai Xénomorphe. Alien ou les mutations d’une franchise de Megan Bédard, paru aux Éditions de ta mère. Patti Smith, des livres d’histoire… n’importe quoi. Lutter par l’absorption d’informations brutes, s’accrocher à celles-ci comme un enfant s’accroche à son jouet préféré, par cette crainte irrationnelle qu’on lui ravisse pour toujours. Gobe, gobe, gobe. Je me sens comme ces extraterrestres ou ces humains du futur qu’on voit dans les films, qui atterrissent sur terre ou à notre époque et qui, grâce à des pouvoirs mentaux inédits, font défiler sur un ordinateur et intègre toute notre culture et notre histoire en trois minutes. Tout y passe, sans distinction ou hiérarchie : des sublimes films de l’Égyptien Shadi Abdel Salam (Le paysan éloquent et La momie) aux vidéos de youtubeurs comme Scott the Woz, analysant avec humour et érudition l’industrie du jeu vidéo.
L’hiver a pris ses aises, mais nous sommes engourdis déjà depuis des mois par la routine et la lumière blafarde de nos écrans. Cet état de flottement perpétuel m’a ramené à la mémoire l’essai documentaire Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais, vu à la Cinémathèque québécoise dans le cadre du Festival du nouveau cinéma en 2019. En retrait du monde suite à une rupture amoureuse difficile, Beauvais voit pour oublier, ou plutôt pour étouffer sa peine, quatre ou cinq films par jour, sur une période de plusieurs mois. Il en tirera un montage d’extraits de 400 métrages, la plupart obscurs, courtepointe rythmant de façon frénétique le récit narré à la première personne d’une perte, et d’un retour graduel à la vie « normale ». Je pense à ce film bouleversant parce que je me demande – et je n’ai pas de réponse – si le cinéma m’aide à oublier, ou au contraire à me souvenir une vie d’avant. Simulacre ou miroir fidèle. Un peu des deux bien sûr.
Présentement mis à l’épreuve dans ses fonctions divertissantes, le cinéma s’avère (je n’en ai jamais vraiment douté) de solides béquilles, et bien qu’il fasse gris dehors et à l’intérieur depuis mars dernier, je sais maintenant que je ne serai jamais tout à fait triste ou désemparé tant que j’aurai des films à ma portée. Tant qu’il me restera des films d’Éric Rohmer à découvrir ou revoir, tant que je pourrai compter sur une comédie de Steve Martin pour me remonter le moral, tant qu’il y aura des tops de fin d’année à établir et la promesse d’un retour dans les salles obscures, où nous pourrons tous nous ensemble saisir l’étrange imprévisibilité du monde.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF
No 324 – Engagez-vous (qu’ils disaient)
23 septembre 2020
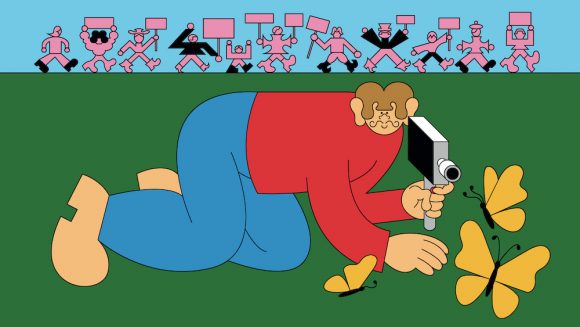
Des « pas de colonne », les Québécois ? Des béni-oui-oui, passifs, aliénés et contents de l’être, au point de n’avoir aucune réelle perspective sur leur condition réelle ? Ou plutôt, le Québec serait-il cet eldorado des rêves et légendes, paradis où tout un chacun peut vaquer à ses occupations l’esprit tranquille, confortable dans le giron d’une province où la justice prévaut et où le racisme systémique n’existerait tout simplement pas ? Et lequel de ces deux extrêmes pourrait expliquer ce flagrant manque d’intérêt de notre cinéma envers notre histoire politique et l’engagement citoyen ? En considérant la totalité de notre production cinématographique des 10 dernières années, il n’y aurait aucune raison de s’insurger au Québec. Ni même d’ériger des monuments à la gloire de nos politiciens ou de nos militants les plus notoires.
Les États-Unis l’ont vite compris (ils l’ont l’affaire) : le cinéma est un fabuleux moyen de se constituer en tant qu’utopie fonctionnelle. Pour citer la célèbre phrase à la fin de The Man Who Shot Liberty Valance : « When the legend becomes fact, print the legend ». Quand la légende devient réalité, imprimez (ou filmez) la légende. Mais pour chaque Mr. Smith Goes to Washington savamment mis en scène, pour chaque hagiographie édifiante, Hollywood produit en contrepartie un All The President’s Men, rappelant qu’il faut demeurer alerte et méfiant face au pouvoir, quel qu’il soit. Ainsi, une sorte d’équilibre est atteint. Au Québec, impossible de s’entendre sur quelle figure à immortaliser, alors qu’un politicien déterminant comme René Lévesque continue de diviser. Malgré deux miniséries télévisuelles au succès mitigé (1994 et 2006), comment imaginer, dans le contexte actuel, qu’un biopic à grand déploiement pourrait lui être consacré ?
Les railleries de la satire sont plus dans nos cordes, du sympathique Guibord s’en va-t-en guerre au cynique Votez Bougon, ainsi que les retours à la crise d’Octobre, blessure encore fraîche, de façon détournée dans Les rois mongols ou frontalement avec La maison du pêcheur et Corbo. Mais cela est bien peu en tenant compte du nombre effarant de récits initiatiques (le je avant le nous) qui nous sont présentement proposés. En dehors des controversés Laurentie et Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie, au sujet de notre marasme identitaire moderne et du legs du Printemps érable, le cinéma politique, engagé ou non (comment ne pourrait-il pas l’être ?), semble autant nous exciter qu’une potentielle suite à French Immersion – C’est la faute à Trudeau. En attendant le jour où un producteur zélé proposera à la SODEC un film sur le règne de Jean Charest, mettant en vedette Paul Doucet, tiens, espérons revoir poindre chez nos cinéastes de fiction une volonté claire de mettre en scène les institutions qui nous constituent et nous régissent. Car il n’y a que les bienheureux, donc les imbéciles, pour ne jamais rien remettre en question.
Le cinquantième anniversaire de la crise d’Octobre est donc une occasion de revenir sur cette question de l’engagement et du politique dans notre cinéma, en prenant comme point de départ la sortie récente du documentaire Les Rose de Félix Rose, vibrant portrait d’une famille marquée par le militantisme, et particulièrement de deux frères qui ont décidé de servir leur cause, l’affranchissement identitaire et économique des Canadiens français, jusqu’à un point de non-retour. De circonstance, on farfouille dans nos archives et on ramène de l’avant un logotype introduit en couverture de notre numéro du mois de février 1971, qui n’a pas pris une ride et qui s’adapte joliment aux éléments graphiques déjà en place. Je profite aussi de l’occasion pour remercier l’artiste-collagiste Jennyfer Bouliane pour cette œuvre originale en couverture, prenant comme matériau de base cette photo devenue emblématique de Paul Rose, poing en l’air.
JASON BÉLIVEAU
RÉDACTEUR EN CHEF







