En couverture
Senia
8 février 2018
CRITIQUE
| DANSE |
★★★★
FORMES INTRIQUÉES
_ Élie Castiel
Chorégraphe atypique de la modernité occidentale, Marcos Morau soumet ses danseurs à un exercice de remise en question les situant dans des zones, certes inconfortables, mais qui par la même occasion leur permet de revendiquer des terrains inconnus de plein droit. Diverses disciplines se conjuguent dans cette vibrante Siena : théâtre, danse, jeux de la perception liés aux corps, des entités physiques qui gesticulent, se déhanchent, poursuivent d’étranges chemins et avant tout, somment le spectateur d’avoir recours à son intelligence.
Tableau à l’appui, La Renaissance italienne s’installe en premier lieu, annonçant une modernité en devenir, se renouvelant sans cesse à travers les siècles. La discipline « moderne » en matière d’arts se développent alors selon les tendances politiques et sociales de chaque période explorée.

Photo © Jesús Robisco
Semaine du 26 janvier au 1er février 2018
25 janvier 2018
AVIS AUX CINÉPHILES
Il arrive parfois que certains films ne soient pas présentés toute la semaine, particulièrement dans les salles indépendantes. Consultez les horaires quotidiens, ceux-ci pouvant changer d’un jour à l’autre.
Dû à des facteurs hors de notre contrôle et au nombre insuffisant de participants, les textes critiques, incluant le « coup de cœur », pourraient enregistrer des retards même si nous faisons tous nos efforts pour l’éviter.
Veuillez noter que certaines bandes-annonces de films étrangers ne sont pas sous-titrées.
| EN SALLE À MONTRÉAL |
<< Cliquez sur chacun des titres pour accéder à la fiche détaillée >>
COUP DE CŒUR
 PADMAAVAT
PADMAAVAT
Sanjay Leela Bhansali
CRITIQUES
Le vénérable W.
Barbet Schroeder
Les scènes fortuites
Guillaume Lambert
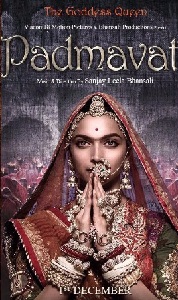
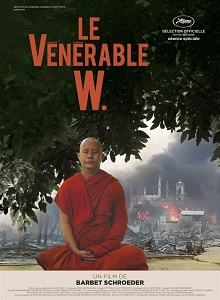

—
SANS COMMENTAIRES
Geek Girls
Gina Haraszhti
Maze Runner: The Death Cure
Wes Ball
Three Heroes and the Princess of Egypt
Konstantin Feoktistov
—
PRÉ-SORTIES SÉLECTIVES
Jeudi 1er février – @ Cineplex
Winchester
Michael Spierig, Peter Spierig
V.o. : anglais / Version française
Winchester : La maison hanté
Classement
Interdit aux moins de 13 ans
(Violence / Horreur)
Fiche détaillée
Semaine du 2 au 8 février
Legend Lin Dance Theatre
CRITIQUE
| DANSE |
The Eternal Tides
★★★★
LOUANGE DE LA LENTEUR
_ Élie Castiel
« La vie va et vient, à l’instar de la montée et du reflux de la marée ». Cette phrase, prise du programme de la soirée, confirme la spiritualité qui imprègne ce spectacle grandiose, inusité, une découverte, car il serait injuste de dire que nous sommes en plein dépaysement; au contraire, et à juste titre, si on saisit le bien-fondé de la chorégraphie dont nous sommes les témoins privilégiés, on reconnaît, à titre d’humain, que le cycle de la vie est un éternel recommencement, de la naissance à la mort. Un rendez-vous avec la grandeur de la nature, le rapport entre l’être et l’animal, entre le terrestre et l’aquacole, leurs correspondances, leurs agressions inévitables, leur limpidité.
Mais c’est aussi le rappel qui confirme que les sociétés occidentales doivent ultimement cesser de courir sans but. Sur ce point, Lin Lee-Chen donne aussi une leçon de comportement à son pays et à d’autres contrées du monde, réglés, aujourd’hui, selon une vision de l’Ouest, où la lenteur n’est pas une qualité, mais un défaut qui mine le progrès économique.

© Michel Cavalca
D’une pensée symétrique exemplaire, la chorégraphe, mythique dans son pays, soumet le corps des danseurs à un rapport avec les divers et multiples mouvements de la vie : générosité et agressivité, amour et turpitude, autonomie et collectivité… Ça relève également autant du théâtre que de l’opéra, amoureux, tragique, en symbiose avec les éléments de l’existence et les règles scéniques de la représentation.
The Eternal Tides se conjugue au passé et par un
tour inhabituel de prestidigitation, se transforme en
une mise en abyme du présent… d’une radieuse beauté.
Si en premier lieu nous ne reconnaissons pas la grammaire chorégraphique, nous restons attentifs à ce qui se passe autour de ce décor prestigieux et d’un raffinement exemplaire, respectueux, le temps de situer notre sens de la perspective dans un domaine inconnu et pourtant si proche de nous. Il suffit de bien comprendre l’individu et sa culture pour parvenir à une symbiose humaine; en filigrane, The Eternal Tides aborde subtilement la notion du vivre-ensemble, qui n’est pas simplement respecter l’autre, mais le comprendre, essayer de lire entre les lignes ce qui nous dérange en lui et réaliser que nous avons tort. Thème d’actualité au Québec dont nous avons hâte qu’il disparaisse. Sans doute, le jour où les individus apprendront à raconter leurs histoires et celles des autres.
Finalement, The Eternal Tides se conjugue au passé et par un tour inhabituel de prestidigitation, se transforme en une mise en abyme du présent. Comme la vie, subtile, élégante, agressive et en même temps d’une radieuse beauté.
![]()
LES MARÉES ÉTERNELLES
Chorégraphie : Lin Lee-Chen – conception visuelle : Lin Lee-Chen – lumières : Cheng Kuo-Yang – costumes : Wang Chia-Hui – chanteur : Hsu Ching-Chwen – batterie : Ho Yi-Ming, Hsiao Ying – danseurs : Corps de ballet du Legend Lin Dance Theatre – production : National Performing Arts Center / National Theater & Concert Hall, Taïwan (Chine) – diffusion : Dance Dance.
Durée
2 h (sans entracte)
Représentations
Jusqu’au 27 janvier 2018
20 h – Place des Arts (Théâtre Maisonneuve)
MISE AUX POINTS
★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes]
Voyage(s)
23 janvier 2018
CRITIQUE
[ SCÈNE ]
★★★★
SABLES MOUVANTS
_ Élie Castiel
Le théâtre expérimental a ceci de particulier qu’il soumet le spectateur à un rapport avec son intellect. Les notions du politique, social, individuel et collectif se retrouvent sur un même espace, le temps d’un dialogue entre les créateurs et le public, la plupart du temps, des complices d’une obsession sur la condition humaine.
Toujours est-il que l’artiste multidisciplinaire Hanna Abd El Nour utilise le mythe comme intervenant à une cause malheureusement malmenée par l’exil, l’ailleurs ; oui, un autre espace inconnu qu’il tente d’amadouer pour finalement retrouver un sens, même minime, de la dignité. Il est dommage que les paroles de Jerusalem in my Heart, étrangement mélancoliques, sortes de mélopées orientales n’étaient pas traduites en surtitres, contrairement aux disciplines comme l’opéra, ou dernièrement, quoique de façon limitée, dans le significatif Warda, au Prospero.
Il est entouré, ou plutôt devient acolyte-victime de Stefan Verna, autre déplacé, expatrié qui, certes, parle moins mais véhicule la pensée par le biais d’une course effrénée à travers un espace scénique en forme de désert. Mais un désert fait de sables mouvants que les quatre protagonistes de cette traversée sans doute biblique tentent d’éviter.
Oui, bien entendu, il y a cette icône de la danse et de la dramaturgie québécoise, Marc Béland, qui proche de la soixantaine, soumet son corps, encore jeune, à une dynamique de la représentation qui a à voir avec la notion d’obsession : passion pour le geste, amour du mouvement, relation incontournable avec la scène, mais surtout un regard jeté sur le spectateur qui oblige ce dernier à intervenir.
Le geste créatif de Hanna Abd El Nour est d’une
lucidité obsédante qui s’abandonne dans les
méandres fragiles et incontournables de l’expérience
humaine. Bouleversant, édifiant, essentiel.

L’ensemble des comédiens © Joseph Elliott Israel Gorman
C’était mon cas, à la première rangée, à quelques pas de lui; je réponds par une expression complice du regard (sans doute, un réflexe dû à mes cours d’interprétation dans un passé lointain, caressé aussi par de très brèves paroles échangées avec lui lorsque nous habitions, je suppose, dans le même, comme on dit ici, « bloc appartement »). Pendant quelques secondes, j’ai eu la chair de poule, mais sensation vite ramenée sur terre par la participation des autres membres de l’équipe.
Les éclairages, faisant partie des personnages, se mettent à la disposition de cet acte de création que remet en question l’expérience théâtrale. Et puis une fin qui n’en est pas une… confirmant de façon à la fois émouvante, sensible et volontairement agressive que « tout change », tel que Arriola nous le rappelle constamment.
Mais une chose est claire : dans la politique actuelle en termes de culture, ce n’est pas une catégorie à part qu’il faut inventer pour ceux venus d’ailleurs; au contraire, ils doivent totalement s’intégrer à l’intérieur de la culture officielle. Les autres endroits du Canada le font; la France l’a toujours fait; les États-Unis (rien à dire à ce sujet; sur ce plan, c’est parfait); quant au Québec, seuls la danse et le théâtre ont courageusement entamé quelques pas. Il ne reste que le cinéma; parce que cette forme de représentation est plus populaire. C’est donc une question politique. Le défi est donc lancé.
En attendant, le geste créatif de Hanna Abd El Nour est d’une lucidité obsédante qui s’abandonne dans les méandres fragiles et incontournables de l’expérience humaine. Bouleversant, édifiant, essentiel.
![]()
Direction artistique : Hanna Abd El Nour – direction de production : Pierre-Yves Serinet – dramatugie et mise en scène : Hanna Abd El Nour – assistance à la mise en scène et régie : Camille Robillard – éclairages : Martin Sirois – costumes : Fruzsina Lanyi – graphisme et web : Hugo Nadeau –– chant, musique et conception sonore : Radwan Moumneh (Jerusalem in My Heart) – distribution : Sylvio Arriola, Marc Béland, Stefan Verna – production : Volte 21 – diffusion : La Chapelle Scènes Contemporaines.
Durée
1 h 20 (sans entracte)
Représentations
Jusqu’au 3 février 2018
MISE AUX POINTS
★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes]
La meute
21 janvier 2018
CRITIQUE
[SCÈNE]
★★★★ ½
BRISER LE CONFORT
ET L’INDIFFÉRENCE
_ Élie Castiel
Sans aucun doute, La Licorne débute la saison hivernale avec, déjà, une des pièces maîtresses de la dramaturgie québécoise moderne; tant par son actualité irréversible, son argumentation lucide, inquiétante, que par sa puissance d’évocation rarement vue dans notre contexte national.
C’est cru, mais pas gratuitement, innovateur dans sa liberté de paroles et de mouvements, et plus que tout, par l’effet dévastateur qu’elle jette sur les spectateurs, totalement décontenancés, surtout à mesure que le récit progresse, jusqu’à la finale, impitoyable. Une fois sortis de la salle, nous sommes impuissants à placer un seul mot.
Bien entendu, il n’est pas nécessaire de rappeler que La meute est en lien direct avec les récentes dénonciations d’abus sexuels, hétérosexuels aussi bien qu’homosexuels. Inutile aussi de souligner que le texte de Catherine Anne Toupin se détache totalement de la controverse Catherine Deneuve & consortium, visant, au contraire, et directement, là où ça blesse et remet les pendules à l’heure en ce qui a trait à la condition masculine : le sexe.

Lise Roy, Guillaume Cy et Catherine-Anne Toupin [ © Suzane O’Neill ]
Warda
CRITIQUE
| SCÈNE |
Élie Castiel
★★★★
LE NOM DE LA ROSE
_ Élie Castiel
La circularité du texte se confond avec ces deux pièces d’architecture sur scène qui ressemblent à des fauteuils, sont utilisés comme tels, ainsi que, selon le cas, comme lits de maison ou d’hôtel, mais ne sont en sorte que des torses terrestres séparés que le metteur en scène Belge, Michaël Delaunoy, en symbiose avec le scénographe Gabriel Tsampalieros, soumet aux yeux des spectateurs pour réfléchir sur la frêle notion des frontières.
La plume de Sébastien Harrison parle des identités, de ces formes existentielles qui, pour ceux frappés par l’exil, deviennent des instruments d’agressivité, des pièces à conviction à éliminer; et pourtant, dans Warda (rose en arabe) parvient à concilier la diversité humaine dans une sorte d’harmonie qui relève du symbolisme de la représentation. Il y Mieke Verdin, la Bruxelloise, incarnant une auteure de livres pour enfants qui, texte oblige, se permet de très légères remarques homophobes, mais au fond pas vraiment méchantes, prises comme des câlins. Elle est d’une présence inouïe, comme d’ailleurs les Québécois Violette Chauveau et Hubert Lemire qui, respectivement, convoquent l’idée de l’ouverture et la peur de l’autre et de l’inconnu (sans doute d’une sexualité non admise – oui, il est question de sexualité). Victoria Diamond est la Canadienne anglophone qui lie du Michel Foucault et parle aussi le français. Son double jeu est hallucinant, sa beauté cachant un jeu glacialement et amoureusement perfide.
Les fourberies de Scapin
19 janvier 2018
CRITIQUE
[ SCÈNE ]
★★★★
VÉRITÉS ET MENSONGES
_ ÉLIE CASTIEL
Il est temps d’arrêter de dire que telle ou telle pièce de théâtre du répertoire classique aborde des thèmes toujours actuels. Justement, nous ne voulons plus nous identifier aux personnages. Pourquoi vraiment le faire? Nous avons compris que le comportement de l’individu fait partie de la condition humaine depuis que le monde est monde.
C’est donc dans un esprit agréablement rassembleur que nous accueillons chaleureusement le premier spectacle 2018 du TNM. Molière, comme il se doit, ne vieillit jamais. Rythme, réparties, amour inconditionnel de la langue française, la plus romantique, la plus exigeante, mais aussi capable de cynisme et d’humanité comme aucune autre – pardonnez-moi de cet élan furtif de chauvinisme non voulu! Soyons d’accord pour reconnaître que derrière ces Fourberies de Scapin, c’est l’art de l’interprétation qui domine, mais dans le même temps, un travail d’équipe qui consiste à transformer cette machine délicieusement infernale qu’est l’aventure dramatique en quelque chose de transcendant, de troublant même.

© Yves Renaud








