Recensions
Francine Laurendeau, celle qui aime
5 mai 2025
La bienveillante
Denis Desjardins
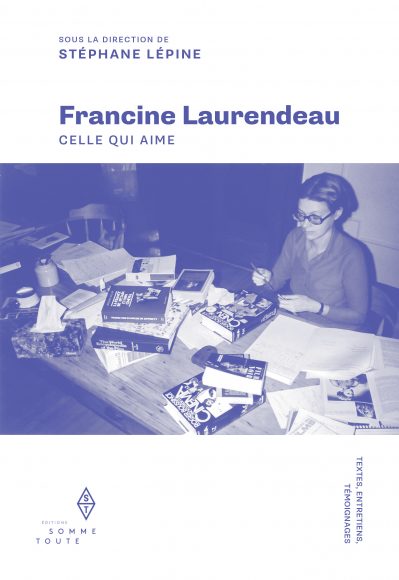
POUR AVOIR EU LA CHANCE de rencontrer Francine Laurendeau dans le cadre de soupers réunissant l’équipe de Séquences sous la houlette de Léo Bonneville — il y a de cela fort longtemps—, le choix du titre de ce livre m’apparaît idoine. Car, en lisant les nombreux témoignages qu’il contient et dont plusieurs soulignent la profonde humanité de cette critique (épithète qu’elle n’a jamais trop aimée), les propos qu’elle m’avait alors tenus me sont revenus en mémoire. Pour Francine Laurendeau, en effet, le rôle principal du critique de cinéma est d’interroger une œuvre et non de manifester à son égard une virulence assassine, justifiée ou non. À ce titre, elle m’a rappelé indirectement George Sand, qui a défendu à son époque une littérature méliorative, refusant de se vautrer dans une fange facile et vulgaire où tous les coups romanesques étaient permis. Laurendeau, même si elle en a éprouvé parfois l’envie, évitait les œuvres qui ne lui parlaient pas, refusant elle-même d’en parler. De plus, elle tentait toujours de situer les films dans leur contexte historique. Comme l’écrit Stéphane Lépine en introduction, « elle n’était inféodée à aucune esthétique, aucune idéologie ou opinion épidermique » (p. 9). Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir des idées bien arrêtées (plutôt à gauche), comme en témoigne son aventure infructueuse à Québec, en 1958. Avec deux condisciples, elle est allée cogner maintes fois à la porte de Maurice Duplessis pour lui faire état de revendications étudiantes. En vain, car le cheuf n’a même pas daigné recevoir le trio. Cet épisode a été évoqué bien plus tard, en 1990, dans L’Histoire des trois (1990), captivant documentaire signé Jean-Claude Labrecque (1).
Cette bienveillance naturelle, Laurendeau l’a pratiquée aussi dans une carrière parallèle, celle d’animatrice et de réalisatrice à la défunte Chaîne culturelle de Radio-Canada, puis à Radio Centre-Ville, lorsque les bonzes de la radio publique ont décidé de « moderniser » les émissions en remerciant leurs meilleurs communicateurs. Ça n’a pas été là la seule déconvenue de la fille d’André Laurendeau, ancien directeur du Devoir; ce journal l’a aussi remerciée, pour des raisons obscures, après 17 ans de service (de 1978 à 1995) et des centaines d’articles. Toutefois, elle a aussi collaboré à Cinéma Québec, Ciné-Bulles et Séquences ! Un parcours somme toute téméraire, selon Georges Privet, qui ajoute que Francine Laurendeau et son compagnon Jean-Claude Labrecque ont voulu laisser les traces d’« un pays sans mémoire » (p. 30), ce pays où la critique a souvent fait plutôt place au « billet d’humeur » (p. 31). Outre Privet, de nombreux proches témoignent, parfois trop brièvement, de leurs liens avec Francine, comme Jeanne Crépeau, Robert Daudelin, Marcel Jean, Roland Smith. Ces hommages alternent avec plusieurs textes publiés par Francine Laurendeau tout au long de sa carrière, dont de solides entrevues avec le compositeur Antoine Duhamel (en grande partie inédite), Louis Malle et Alain Resnais (pour Séquences), ainsi que Gilles Carle (pour Cinéma Québec). Contre vents et marées, elle n’a pas hésité à défendre ce dernier malgré l’échec critique et public de L’ange et la femme, en 1977. Idem avec Pour le meilleur et pour le pire de Claude Jutra, film éreinté par la plupart des journalistes en 1975. Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’admirer la ténacité de Francine Laurendeau, qui n’hésitait pas à donner la parole à certains mal-aimés. Voilà d’ailleurs une de ses qualités premières : une rare capacité d’écoute, appréciée au fil de ses entrevues à Radio-Canada et à Radio Centre-Ville. Toutefois, l’entrevue la plus révélatrice reste celle, en quatre parties, que Stéphane Lépine lui a consacrée aux fins de ce livre. « J’aime les films qui nous font revisiter les grands problèmes sociaux ou politiques, affirme-t-elle, comme Ma nuit chez Maud de Rohmer, où l’on revoit le pari de Pascal » (p. 39). Un canevas passionnant pour celle qui se méfiait de ceux qui « affirm[ent] le primat de la mise en scène au détriment du sujet » (p. 16). Elle dit aussi avoir beaucoup admiré les cinéastes est-européens qui ont su déjouer la censure de l’époque précédant la chute du mur de Berlin.
Le livre — très réussi, malgré une page couverture un peu austère — se termine par un ultime témoignage, et non le moindre, celui de son frère Jean Laurendeau. Laissons aux lecteurs le soin d’en découvrir la teneur.
Note
(1) Film à voir ou à revoir sur le site Web de l’ONF.
—
Francine Laurendeau, celle qui aime
Sous la direction de Stéphane Lépine
Éditions Somme toute
2024, 226 pages
Ce texte est initialement paru dans le numéro 341 de la revue (hiver 2025)







